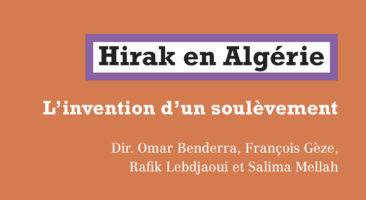Alerte ! Faire face à l’urgence sociale
Mohand Amokrane Cherifi, El Watan, 19 avril 2021
Le Constat
Lorsque le phénomène de pauvreté est très avancé, comme c’est le cas en Algérie, et s’étend rapidement aux couches moyennes de la population, alors nous sommes dans un seuil d’alerte maximum. Cela s’est aggravé rapidement du fait de la crise sanitaire et économique et de ses retombées négatives sur l’emploi et le pouvoir d’achat de toutes les catégories de population, dans notre pays comme dans le reste du monde.
Dans un tel contexte, il faut agir fort et vite. Encore faut-il cerner précisément ce phénomène. Or, les premiers concernés sont les gouvernements, lesquels ne veulent en aucun cas reconnaître l’existence de la pauvreté dans leurs pays respectifs, signe de mauvaise gouvernance et de mauvaise allocation des ressources nationales et donc suicidaire pour leur carrière politique.
C’est le cas dans notre pays où le régime fait silence sur la Journée Internationale pour l’Élimination de la Pauvreté commémorée chaque année dans le monde. J’ajouterai un autre facteur qui rend la paupérisation difficile à évaluer : le silence des pauvres eux-mêmes qui, par pudeur ou par fierté, cachent leur condition sociale.
En Algérie, ceci est si vrai que rares sont les autorités en mesure de définir précisément les familles nécessiteuses de leur territoire du fait de l’absence d’étude locale dans ce domaine et surtout du fait que les nécessiteux sont réticents à venir quémander l’aide de l’Etat car le plus souvent gênés par le regard de leurs concitoyens derrière les guichets de l’Administration.
Ce qui est encore surprenant en Algérie, c’est le fait que, contrairement à d’autres pays, les citoyens bien politisés se mobilisent davantage pour revendiquer l’instauration de la démocratie et d’un Etat de droit sans exprimer l’urgente nécessite d’éradiquer la pauvreté et l’exclusion sociale, et ce, en dépit de leurs conditions de vie et de travail de plus en plus précaires. Ils ont raison de considérer qu’un changement de régime politique réglerait la question sociale. Mais cela prend du temps.
La population, lasse d’attendre, exprime sa colère de temps à autre par des manifestations spontanées et ponctuelles dans des villages ou des quartiers, pour améliorer leur accès à l’eau, à l’électricité ou à un relogement décent, mais l’on n’assiste pas à un mouvement national pour exiger précisément la sauvegarde de l’emploi et du pouvoir d’achat, une allocation plus équitable des ressources et la fin des inégalités sociales, en dépit des efforts de mobilisation des partis, des syndicats et des associations.
Ne disposant pas d’informations fiables sur la population pauvre – celle qui n’arrive pas, par ses revenus, à bien se nourrir, à mieux se soigner et à se loger décemment – m’a amené à procéder à une analyse des conséquences visibles de cette pauvreté pour mesurer l’ampleur de ce phénomène. Cette grille d’analyse expérimentée dans d’autres pays m’a permis d’apprécier le degré de gravité de ce fléau qui gangrène notre société majoritairement urbanisée. L’exode de nos populations vers les villes rend cette pauvreté relativement moins importante et moins visible dans les campagnes où la solidarité familiale, voire villageoise, pallie la faiblesse de la protection sociale de l’Etat.
Compte tenu de la crise sanitaire et de son impact sur les activités économiques, qui entraînent une baisse drastique des revenus des ménages, le premier indicateur constaté est l’insécurité alimentaire dans les quartiers populaires. Comme dans de nombreux pays en développement, les familles algériennes qui ont vu leurs revenus baisser, ont développé une stratégie d’adaptation pour faire face à une alimentation devenue trop chère par rapport à leur pouvoir d’achat. Les adultes diminuent leur consommation au profit de leurs enfants ou réduisent le nombre de repas dans la journée, voire la quantité de nourriture dans l’assiette. On ne peut pas parler de faim mais de diminution relative de la ration énergétique dans de nombreux foyers.
On constate également un déséquilibre de régime avec une consommation très faible de produits frais et de viandes car trop chers. Ils n’avoueront jamais leur détresse, mais il suffit d’interroger les commerçants de fruits et légumes et les bouchers pour se voir répondre : «Les gens n’achètent plus rien, car ils n’ont plus d’argent.» C’est certainement exagéré mais il y a du vrai dans cette affirmation compte tenu de la chute des revenus, la dépréciation du dinar et l’inflation galopante.
De nombreux pays qui connaissent ce phénomène ne sont pas restés passifs. Pour assurer un régime alimentaire équilibré aux enfants, le système des cantines scolaires a été réactivé et généralisé avec un protocole sanitaire strict en cette période de pandémie. Certains Etats vont plus loin en allouant des bons d’achat alimentaire aux familles nécessiteuses recensées dans chaque commune, en plus des programmes de protection sociale existants, pas toujours suffisants ou performants.
Au-delà de la question alimentaire qui est un indicateur basique de la pauvreté, la réduction des activités de nombreuses entreprises et le commerce informel rendu impossible du fait du confinement alimentent de nombreux maux sociaux que rapportent quotidiennement la presse et ce n’est pas spécifique à notre pays.
Ces maux sociaux sont visibles dans le paysage urbain : la circulation en grande quantité de la drogue dans le pays avec de plus en plus de consommateurs parmi les jeunes ; la mendicité qui augmente ; la prostitution qui se développe à grande échelle ; l’ouverture de lieux de boissons alcoolisés clandestins hors de tout contrôle pour répondre à une demande croissante ; les délits de droits communs ; les trafics en tous genres de plus en plus fréquents. Les gens s’enivrent pour oublier leur détresse sociale, la difficulté à trouver un emploi et l’absence de perspective. Le pire de tout est l’émigration clandestine avec de plus en plus de candidats, empruntant des bateaux de fortune au péril de leur vie pour fuir la misère et le manque d’avenir.
Recommandations
J’ai volontairement évoqué ce phénomène de pauvreté de façon qualitative et non quantitative, pour ne pas être alarmiste. L’objectif étant d’inciter l’Etat à prendre conscience de la gravité de la misère qui avance rapidement et silencieusement et sous différentes formes, comme le cancer dans le corps de la société, et cerner précisément ce phénomène pour prendre des mesures adéquates à court, moyen et long terme, afin de l’éradiquer définitivement, avec comme objectif celui adopté par de nombreux pays : Zéro pauvreté.
Ceci est d’importance car nous ne devons jamais oublier que dans le contexte actuel de paupérisation de la population (un Algérien sur 3, un jeune sur 2), la priorité des priorités est de satisfaire les besoins basiques des familles nécessiteuses. A cet effet, il existe une solution radicale pour y parvenir : l’attribution d’un revenu minimum de base à chaque Algérienne et Algérien sans ressources.
Au-delà de l’urgence sociale à traiter, il faudra s’attaquer aux causes de la pauvreté. Voici une série de mesures qui ont fait leur preuve dans de nombreux pays :
– La création d’emplois durables (dans l’agriculture et les services notamment), qui est naturellement la voie essentielle susceptible d’enrayer la pauvreté, avec un niveau des salaires qui préserve le pouvoir d’achat;
– Une politique macro-économique qui stabilise la monnaie, réduit l’inflation et alloue équitablement les ressources en faveur des couches défavorisées de la population ;
– L’assainissement des finances publiques en réduisant le train de vie de l’Etat et en luttant plus efficacement contre la corruption ;
– L’accès aux services sociaux de base pour tous, sans discrimination;
– La réforme de la protection sociale, y compris des subventions, pour cibler les plus démunis, et la gestion décentralisée des ressources qui lui sont affectées.
Un tel programme ferait consensus sur le plan économique et social.
Par Mohand Amokrane Cherifi
Expert auprès des Nations Unies à Genève
Diplômé de l’Université de Harvard ( Etats-Unis)
Fondateur de “l’Alliance Mondiale des Villes contre la Pauvreté”, au sein du Programme des Nations unies pour le Développement