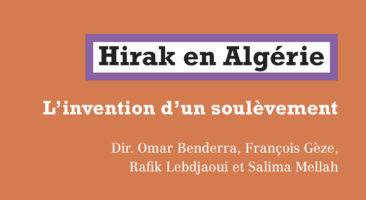Les hommes de Bouteflika
Les hommes de Bouteflika.
Jeune Afrique, 16 août 1999
Le chef de l’État n’a pas encore nommé l’équipe avec laquelle il compte diriger le pays. Toutefois il a déjà commencé à recruter.
Plus de quatre mois après son élection, le président Abdelaziz Bouteflika n’a toujours pas changé de gouvernement ni annoncé de nomination au palais d’El-Mouradia. Il lui faudra pourtant affronter bientôt des échéances, tant intérieures, avec le référendum sur la concorde civile, que diplomatiques, avec l’assemblée générale de l’ONU, et son escale à Paris, en septembre. Conscient que les mours politiques qu’il a connues il y a deux décennies ne correspondent plus aux conditions actuelles, il entend probablement favoriser l’évolution des comportements et l’éclosion d’une classe politique nouvelle. Mais il ne veut pas se précipiter. » Cent jours ne sont rien quand on a patienté vingt ans « , confiait fin juillet l’un de ses proches. Bouteflika centralise les décisions, distribue les rôles et vérifie que chacun applique ses directives sans les déformer. Si gouverner c’est prévoir, comment et avec qui conçoit-il sa stratégie politique ? Durant la guerre de libération, Bouteflika a côtoyé des hommes dont il a apprécié l’intelligence, la loyauté ou les qualités humaines. Il a pu, au cours de sa longue carrière à la tête de la diplomatie algérienne (1963-1979), distinguer et diriger de jeunes cadres algériens à l’avenir prometteur. Sa traversée du désert (1979-1999) lui a permis de découvrir ses véritables amis, quand les courtisans de tous bords lui tournaient le dos. Il ne manque donc pas de noms pour former l’équipe officielle et informelle avec laquelle il affrontera les difficultés qui jalonneront inévitablement son mandat présidentiel. On peut, sans trop de risques, évoquer un certain nombre de personnalités sur lesquelles il s’appuiera dans chacun des quatre principaux secteurs de son action : relations extérieures ; sécurité et défense ; politique intérieure ; développement économique et social. Certains ont un passé riche d’expériences, d’autres sont de nouveaux venus sur l’avant-scène, tous ont au moins deux atouts indispensables : la compétence et la confiance du chef.
Sécurité et défense.
Parmi les hommes de confiance de Bouteflika, on cite fréquemment le nom du général à la retraite Larbi Belkheir. L’ancien directeur de cabinet de Chadli Bendjedid et ex-ministre de l’Intérieur de Mohamed Boudiaf a, certes, joué un rôle important au début de la campagne électorale du candidat Bouteflika. C’est lui qui aurait convaincu ses collègues généraux à la retraite de voter pour l’ancien ministre des Affaires étrangères de Boumedienne. S’il est peu vraisemblable que Belkheir occupe des fonctions officielles, il pourrait servir de liaison
entre la présidence et l’armée, dont Bouteflika ne connaît pas tous les acteurs. Nombre de postes de commandement, en effet, sont aujourd’hui occupés par des officiers qui étaient en début de carrière à l’époque de Boumedienne. Par ailleurs, à quelques rares exceptions près – notamment le chef d’état-major, le général Mohamed Lamari -, les généraux influents sont, d’une manière ou d’une autre, redevables à Larbi Belkheir d’un poste ou d’un avancement. Au nombre de ceux dont le nom circule, Noureddine Zerhouni, plus connu sous le nom de guerre de Yazid, est né en 1938 au Maroc. Il est ce qu’on appelle en Algérie un » Malgache « , dénomination donnée à tous ceux qui ont fait leurs premières armes au ministère de l’Armement et des liaisons générales (Malg), ancêtre de la Sécurité militaire (SM) créée en 1958 par Abdelhafid Boussouf. Yazid a rejoint le maquis en 1956, à l’appel du FLN, alors qu’il préparait son bac. Au lendemain de l’indépendance, Kasdi Merbah, patron des services, lui confie la structuration de la SM. Il lance le service action, qui devient très vite opérationnel, et collabore avec le ministre des Affaires étrangères, notamment dans les opérations de soutien aux mouvements de libération africains. En outre, il gère le dossier le plus sensible de l’heure : le Sahara occidental. Chadli entendait » déboumédienniser » le système et n’a jamais fait mystère de la haine qu’il vouait aux anciens du Malg. Il a écarté Kasdi Merbah de la SM en le plaçant sur une voie de garage au poste de secrétaire général du ministère de la Défense. Yazid, alors lieutenant-colonel, lui a succédé, mais la présidence l’a éloigné d’Alger. Nommé ambassadeur d’Algérie à Mexico en 1982, puis, en 1987, à Washington, il n’est revenu en Algérie qu’au lendemain de la » démission » de Chadli, en 1992. Yazid a alors 54 ans, il part à la retraite. En mai 1999, Bouteflika le rappelle pour le charger de diriger le Comité d’organisation du sommet de l’OUA. Ce n’est certainement pas une simple mission ponctuelle. Bouteflika envisage probablement de lui confier un dossier des plus importants : une réflexion sur la réforme de l’armée et des services de sécurité. Yazid en a les moyens et l’envergure. Pour la direction du protocole, mais aussi pour sa sécurité personnelle, Bouteflika mise sur un autre militaire au passé brillant : le général Salim Benabdallah. Cet ancien pilote de l’avion présidentiel de Boumedienne a connu Bouteflika bien avant l’indépendance. Né en 1938 dans l’Ouest, » Slim « , comme l’appellent ses amis, a interrompu ses études pour rejoindre en 1955 – il n’avait pas encore 18 ans – l’Armée de libération nationale (ALN). Il se battra dans le Sud-Ouest algérien. Servant plus tard parmi les cadres de la wilaya V, le » groupe d’Oujda « , sous le commandement de Houari Boumedienne, il côtoie Kaïd Ahmed, Mohamed Medheghri (tous deux décédés), Si Djamel, nom de guerre de Cherif Belkacem, etc. Mais, c’est peut-être avec un certain Si Abdelkader, de son vrai nom Abdelaziz Bouteflika, qu’il entretient les rapports les plus réguliers. À la veille de l’indépendance, Salim Benabdallah est envoyé au Caire pour y recevoir une formation de pilote de chasse. Il suit, à la fin des années soixante, en Union soviétique, des stages complémentaires sur appareils gros-porteurs. À son retour, il pilotera régulièrement l’avion présidentiel. Au début des années soixante-dix, Boumedienne le charge de constituer le Groupe de liaisons aériennes ministérielles (Glam). Bouteflika voyage beaucoup et a souvent affaire à Benabdallah. Les deux hommes, qui s’apprécient mutuellement, renforceront leur bonne entente pendant cette période. » Slim » est nommé attaché de défense à l’ambassade d’Algérie au Niger en 1980, puis, deux ans plus tard, aux États-Unis. Il y demeure en poste pendant huit ans et voit passer à Washington la plupart des dignitaires algériens en fonctions ou en réserve comme… Abdelaziz Bouteflika. De 1987 à 1990, il est l’un des principaux collaborateurs de l’ambassadeur Noureddine Zerhouni, » Yazid « . Rentré à Alger, fin 1990, il prend la direction des Relations extérieures et de la coopération au ministère de la Défense (DRE), poste stratégique qui coiffe l’ensemble des bureaux militaires dans les représentations diplomatiques. En juillet 1996, il fait valoir ses droits à la retraite. Une fois élu, Bouteflika – qui a l’intention de voyager souvent et de recevoir beaucoup – l’appelle pour lui confier la direction générale du protocole en raison, certainement, de son expérience des États-Unis, de son savoir-vivre – on le dit courtois et avenant -, mais peut-être, et surtout, pour sa légendaire discrétion. Son savoir-faire en matière d’organisation de la sécurité pourrait inciter Bouteflika à lui confier la restructuration de la Direction de la sécurité et de la protection présidentielle (DSPP), qui dépend de la Direction du renseignement et de la sécurité (DRS), donc du général Mohamed Mediene, plus connu sous le pseudonyme de Toufik. Une fois repensée, la DSPP pourrait être placée sous la responsabilité du colonel Abdelali, attaché de défense à Washington, qui remplacerait le colonel Sadek. Autre officier remarqué aux côtés du président lors des entretiens et audiences : le colonel à la retraite Rachid Aissat, la soixantaine. Il semble appelé à jouer un rôle significatif dans les dossiers liés à la fois à la sécurité et aux relations internationales : ancien de la DRE, très proche de Yazid Zerhouni, il aurait souvent croisé Bouteflika, alors consultant dans les pays du Golfe où lui-même s’était installé au lendemain de son départ à la retraite. L’un des principaux corps des forces de sécurité pourrait changer de patron dans un proche avenir : la gendarmerie. On évoque à Alger avec insistance » l’imminent » rappel du général Fodil Bey, ancien commandant de la Ire région militaire, écarté en 1997 par Mohamed Betchine, alors proche conseiller de Liamine Zéroual. Attaché de défense à Bruxelles, en charge, entre autres, du développement des relations de l’Algérie avec l’Otan, Fodil Bey pourrait succéder au général Tayeb Derradji à la tête de la gendarmerie. Enfin, Bouteflika s’appuie sur les principaux chefs de l’armée : notamment, le chef d’état-major Mohamed Lamari, 58 ans, le général-major Toufik, 58 ans, chef de la DRS et le général-major Smaïn Lamari, 56 ans, adjoint de Toufik et directeur de la Sécurité intérieure. Tous trois ont joué un rôle prépondérant dans le maintien de l’homogénéité de l’institution militaire, dans la lutte antiterroriste et dans l’accord de trêve avec l’AIS. Ils ont, en outre, assuré le déroulement sans incidents de la campagne et de l’élection présidentielles, ainsi que du sommet de l’OUA. Contrairement à certaines rumeurs, Bouteflika les consulte régulièrement sur les dossiers sensibles.
Diplomatie et relations extérieures.
Ancien journaliste du quotidien El Moudjahid, Abdelkader Messahel, que tout le monde appelle » Dadi « , est venu à la diplomatie, au début des années soixante-dix, à la demande de Bouteflika. Il fait ses premières armes à New York, au siège des Nations unies, et devient le témoin privilégié de l’action de Bouteflika, alors président de l’Assemblée générale de l’ONU. Depuis, il s’est spécialisé sur l’Afrique. Il a assisté aux vingt derniers sommets de l’OUA, a dirigé à deux reprises la Direction générale Afrique au ministère des Affaires étrangères et a été ambassadeur d’Algérie au Burkina, de 1987 à 1991. Il est aujourd’hui ambassadeur à La Haye, d’où il a été rappelé pour participer à la préparation politique du sommet d’Alger. Travailleur infatigable, » Dadi » excelle dans l’action en coulisses. En charge du dossier sahraoui, il a participé à l’organisation du dialogue entre Marocains et membres du Polisario, à Barcelone, et aux différents rounds de Houston. Il devait rejoindre son poste aux Pays-Bas, mais a été chargé le 4 août d’une mission spéciale auprès de Laurent-Désiré Kabila en République démocratique du Congo. D’aucuns lui prédisent le rôle de » Monsieur Afrique « . L’un des parrains de » Dadi « , Boualem Bessayeh, ancien chef de la diplomatie dans le gouvernement Merbah, a repris du service à l’occasion du sommet de l’OUA, où Bouteflika l’a nommé porte-parole de la délégation algérienne. Aujourd’hui sénateur, Bessayeh pourrait, en homme de lettres (il a notamment écrit la biographie de l’émir Abdelkader), ajouter une touche culturelle à l’action diplomatique. Abdelkader Tafar, ancien secrétaire général des Affaires étrangères, a été nommé par Zéroual conseiller diplomatique. Il figure parmi les rares rescapés du staff de l’ancien président après l’arrivée de Bouteflika au palais d’El-Mouradia. Durant les travaux du sommet de l’OUA, Tafar faisait partie de l’équipe des conseillers diplomatiques du chef de l’État. Redha Malek, ancien membre du Haut Comité d’État (présidence collégiale) et chef du gouvernement en 1993, a mis entre parenthèses sa position de chef d’un parti d’opposition, l’Alliance nationale républicaine (ANR), pour accomplir, fin juin, à la demande du président, une mission préparatoire au sommet de l’OUA aux allures de périple, en Afrique de l’Ouest. Larbi Belkheir, outre son rôle déjà évoqué dans les questions de sécurité, sera probablement sollicité pour accomplir des missions ponctuelles, notamment dans les capitales occidentales, où il dispose d’un solide réseau de relations. Il s’est rendu en France, en mai, et aux États-Unis, en juin, quand il a été question qu’Alger reprenne langue avec Paris et Washington. Mohamed Bedjaoui, 63 ans, juge à la Cour internationale de justice de La Haye et ancien représentant permanent de l’Algérie auprès des Nations unies, devrait également être consulté par Bouteflika sur les grandes affaires à la fois diplomatiques et juridiques.
Politique intérieure.
A cheval sur les affaires extérieures et intérieures, l’ancien chef du gouvernement, Ahmed Ouyahia, 46 ans, a lui aussi effectué plusieurs missions » africaines » pour le président. Il est en charge du dossier Érythrée-Éthiopie. Sa position de secrétaire général du Rassemblement national démocratique (RND) lui confère le rôle clé dans la cohésion de la coalition des partis pro-Bouteflika. Proche d’entre les proches, Ali Benflis, né en 1944, est issu d’une grande famille de Batna, à l’est du pays. Il est beaucoup plus qu’un » alibi régional « . Une véritable complicité le lie au président. Elle s’est forgée en 1987. Cette année-là, tandis que Bouteflika décide de mettre fin à son exil et de retourner à Alger, l’avocat Ali Benflis, militant actif du FLN, sort de l’anonymat pour créer, avec Me Miloud Brahimi, la Ligue algérienne des droits de l’homme. En octobre 1988, l’Algérie vit un véritable séisme quand l’armée tire sur des manifestants pour rétablir l’ordre. Le président Chadli perd pied, appelle à la rescousse Abdelhamid Mehri, son beau-frère, alors ambassadeur à Rabat, pour prendre les rênes du FLN. Bouteflika, pour la première fois depuis son limogeage en 1979, sort de sa réserve et signe avec dix-sept personnalités une déclaration réclamant démocratisation et moralisation de la vie publique. Devenu très vite homme de confiance de Mehri, Benflis demande et obtient en 1989 la réintégration de Bouteflika au sein du Comité central. L’ancien ministre n’oubliera pas ce geste. Les deux hommes se voient beaucoup pour d’interminables dialogues sur la situation politique qui se dégrade au fil des jours. Quand, en janvier 1992, le processus électoral est interrompu, Ali Benflis reste fidèle à la ligne de Mehri, mais il prend ses distances quand ce dernier opte pour la démarche de Sant’ Egidio. En 1995, un putsch au sein du FLN l’éloigne de la direction du parti. Bouteflika lui confie la direction de sa campagne électorale en février 1999. Une fois élu, il le nomme secrétaire général de la présidence. Personnalité » historique « , ministre de Boumedienne et ancien président de l’Assemblée populaire nationale, Rabah Bitat, 70 ans, a immédiatement appuyé les efforts de Bouteflika, tant pendant la campagne électorale qu’après l’élection présidentielle, dans ses relations avec les chefs de certains partis politiques. Il a, par ailleurs, accompli plusieurs missions diplomatiques lors de la préparation du sommet de l’OUA, se rendant notamment à Tripoli auprès du colonel Kaddafi. Abdelkader Maghlaoui, ancien wali et député du Rassemblement national démocratique (RND), parti créé en 1996 pour soutenir l’ancien président Zéroual, a été le premier à soutenir la candidature de Bouteflika et à convaincre d’autres militants du RND de l’imiter. Durant la campagne électorale, il a coordonné les activités des partis de la coalition (FLN, RND, Ennahda, MSP).
Développement économique et social.
Fatiha Mentouri, fille de feu le professeur Béchir Mentouri, éminent cardiologue, et nièce de l’actuel président du Conseil national économique et social (Cnes), est l’une des plus brillantes économistes algériennes et possède, dit-on, une forte personnalité. Après avoir achevé ses études aux États-Unis, en 1986, elle rejoint la Banque centrale d’Algérie. En 1994, elle participe aux négociations avec le Fonds monétaire international. À la suite d’un désaccord avec l’actuel ministre des Finances, Abdelkrim Harchaoui – il dirigeait la délégation algérienne lors de ces négociations à Washington -, elle démissionne. Depuis, elle a disparu de la circulation pour réapparaître en Suisse, le 26 juin 1999, au côté de Bouteflika, au Forum économique de Crans Montana. Son premier dossier est tout trouvé : faut-il revenir au FMI ? Cette question risque de provoquer des débats passionnés, car les économistes ne partagent pas le même point de vue. Ainsi, le professeur Abdelatif Benachenhou, qui enseigne à la faculté de sciences économiques d’Alger, défend des thèses libérales, ses publications l’attestent. De son côté, l’ancien ministre des Finances, Ahmed Benbitour, aujourd’hui sénateur, prône une politique économique aussi indépendante que possible des injonctions du FMI. Il serait pressenti pour le poste de gouverneur de la Banque d’Algérie. Si cette nomination se confirmait, la Banque centrale retrouverait à sa tête un Mozabite, communauté réputée pour son savoir-faire en matière de commerce et de finances et ce, six ans après le départ de Hadj Nacer. Sur le dossier de l’énergie, le président compte sur les compétences de l’ancien PDG de la Sonatrach, Abdelkader Bouhafs, mais aussi sur celles de Youcef Yousfi, actuel ministre de l’Énergie, qui a été lui aussi consultant dans les pays du Golfe en même temps que Bouteflika. Dans les secteurs sociaux, les priorités se disputent la première place : logement, éducation, santé, aménagement du territoire… En ce domaine, Cherif Rahmani est souvent cité. Énarque âgé de 55 ans, il a commencé à faire parler de lui quand il a dirigé le ministère de l’Équipement dans le gouvernement de Mouloud Hamrouche. Après une éclipse, il revient au premier plan, en 1996, pour un poste taillé à ses mesures : ministre-gouverneur du Grand-Alger. Il y démontrera ses talents dans l’aménagement de l’espace urbain, la résorption des bidonvilles et la restauration du patrimoine local. On lui doit la réhabilitation de la ville d’Alger (voir J.A. n° 1980-1981 : » Alger fait peau neuve « ). Bouteflika a apprécié le résultat de son travail lors de la tenue des assises africaines en juillet. Il pourrait lui confier un nouveau ministère, celui de la Ville. Ahmed Djiar, bras droit de Benflis et ancien wali, prendrait en charge, quant à lui, le gouvernorat d’Alger. Pour les secteurs socio-économiques, le président consultera Mohamed Salah Mentouri, président du Cnes, connu pour son objectivité, mais surtout pour ses prises de position contre » l’économie de bazar » décriée par le président algérien.