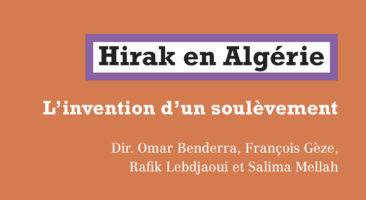Bensaïd et Belkacem comparaissent à partir d’aujourd’hui à Paris
Attentats de 1995: deux hommes du GIA aux assises
Bensaïd et Belkacem comparaissent à partir d’aujourd’hui à Paris
Patricia Tourancheau, Libération, 1 octobre 2002
Boualem Bensaïd et Aït Ali Belkacem se voient reprocher trois actes de terrorisme sur les neuf qui ont été commis entre le 11 juillet et le 17 octobre 1995. eux intégristes algériens, Boualem Bensaïd et Smain Aït Ali Belkacem, 34 ans tous les deux, répondent aujourd’hui et jusqu’au 31 octobre de trois attentats de 1995 devant la cour d’assises spéciale de Paris, présidée par Jean-Pierre Getti et composée de magistrats professionnels. Face aux deux accusés, la moitié des 182 parties civiles représentées par l’association SOS-Attentats, familles de défunts, victimes mutilées ou blessées, comptent assister à ce procès. En marge de la salle d’audience, une cellule d’assistance psychologique a été installée, ainsi qu’une retransmission vidéo pour les médias.
78 tomes. Les familles déplorent l’absence d’un troisième accusé, Rachid Ramda, financier présumé de la vague d’attentats que la Grande-Bretagne refuse d’extrader (lire ci-dessous). Les deux hommes présents dans le box se voient reprocher trois actes de terrorisme sur les neuf qui ont été commis entre le 11 juillet et le 17 octobre 1995. Au bout de sept ans d’instruction et 78 tomes de procédure, Bensaïd comparaît cette fois comme auteur principal de l’attentat le plus meurtrier (25 juillet, 8 morts et 150 blessés) dans la station Saint-Michel du RER mais aussi de celui du métro Maison-Blanche (6 octobre, 18 blessés), enfin comme complice du dernier acte à la station Musée d’Orsay du RER (17 octobre, 30 blessés). De son côté, Belkacem est accusé d’avoir déposé lui-même l’engin de musée d’Orsay.
Les deux accusés se revendiquent du Groupe islamique armé (GIA), parti en guerre contre le régime algérien après l’annulation en 1991 des élections donnant l’avantage aux candidats islamistes, puis contre les « suppôts » français du pouvoir en place. L’enlèvement attribué au GIA de trois employés du consulat de France à Alger, en novembre 1993, avait provoqué dans l’Hexagone le début de la chasse aux réseaux de soutien aux maquis algériens : 88 sympathisants interpellés, parfois expulsés. Par la suite, les attaques contre des Français en Algérie se sont multipliées, et les rafles tous azimuts en milieux islamistes en France aussi. La tension a culminé à Noël 1994 avec le détournement d’un Airbus d’Air France à Alger par un commando du GIA, l’exécution de trois des 230 passagers, et l’intervention du GIGN à Marseille qui a liquidé quatre preneurs d’otages.
Réseau. Six mois plus tard, Bensaïd et Belkacem sont spécialement dépêchés à Paris pour porter le Jihad (guerre sainte) en France, et épauler un obscur émir appelé Ali Touchent qui a recruté des soldats de l’islam dans les banlieues. Bensaïd, coordinateur des groupes (de Lyon, Lille et Paris), et Belkacem, artificier itinérant, ont déjà été condamnés à dix ans de prison pour « association de malfaiteurs liée à une entreprise terroriste » par le tribunal correctionnel, en 1999, aux côtés de vingt membres du réseau. Par ailleurs, Bensaïd a déjà été jugé coupable de l’action échouée contre le TGV Paris-Lyon le 26 août 1995, et a écopé de trente ans de réclusion en 2000.
Si une empreinte digitale de Bensaïd a été relevée sur l’engin de Maison-Blanche, ses avocats Mes Dietsch et Barbe contestent son implication directe dans l’attentat du RER à Saint-Michel, « établie sur les accusations incohérentes et évolutives de Slimani », un Lyonnais du réseau, « même pas cité par l’avocat général », Gino Necchi : « Il fallait un coupable à tout prix, mais ce n’est pas Bensaïd », tranche la défense qui s’étonne « de l’étrange facilité avec laquelle son chef Ali Touchent a pu échapper à trois coups de filet avant qu’Alger n’annonce sa mort ». A défaut de Ramda et de Touchent, la présidente de SOS-Attentats Françoise Rudetzki s’accroche à « Bensaïd et Belkacem » : « Je vous accorde que tous les responsables ne sont pas là, mais ce procès n’est pas celui du GIA. ».
……………………………
Ce 25 juillet-là, huit morts à la station Saint-Michel La bonbonne de gaz mène rapidement les enquêteurs sur la piste du GIA. Kelkal est tué deux mois après, Bensaïd arrêté.
Par Patricia Tourancheau, Libération, 1 octobre 2002
C’est une trace de doigt sur l’engin retrouvé sur la voie du TGV à Cailloux-sur-Fontaines (Rhône) le 26 août qui aiguille les enquêteurs sur Khaled Kelkal, petit délinquant lyonnais. e 25 juillet 1995, à 17 h 30, l’explosion d’une bombe dans le RER ligne B à la station Saint-Michel provoque un séisme national. Corps déchiquetés, jambes coupées, poumons « blastés », passagers mutilés, brûlés ou « polycriblés » par les éclats de verre et de métal. L’effet de souffle a déformé la structure de la sixième voiture du RER « Gare du Nord-Saint-Rémy-Les-Chevreuses », a arraché portes et banquettes. Transformé les ressorts des sièges en projectiles mortels. Pompiers et secours désincarcèrent les victimes et évacuent les blessés, par dizaines. Trois plans d’urgence sont déclenchés. Les sirènes hurlent dans l’île de la Cité, toute proche, bouclée.
Appel à témoins. Secoués par ce retour du terrorisme aveugle qui rappelle les attentats téléguidés par l’Iran en 1985-86, le président de la République et les ministres descendent dans la station sinistrée. Le plan de prévention des attentats Vigipirate est actionné, les mesures de sécurité renforcées dans les lieux publics. Le ministre de l’Intérieur, Jean-Louis Debré, réunit un comité interministériel de lutte antiterroriste qui envisage deux hypothèses liées aux engagements internationaux du pays : les islamistes à cause de l’Algérie ou les Serbes en raison du conflit en Bosnie. Faute de revendication, Debré lance un appel à témoins et promet un million de francs à qui permettra d’identifier les terroristes. L’appât de la prime déclenche des centaines d’appels plutôt « loufoques » qui saturent la police et ne mènent à rien. La diffusion – imposée aux policiers – de trois portraits-robots de Maghrébins suscite aussi des vérifications stériles. Les indices manquent.
Seuls, les débris de l’engin parlent. Il s’agit d’une bonbonne de gaz de camping, remplie de poudre noire et de mitraille (clous, boulons), avec un réveil pour retardateur. Une « bombe du pauvre » qui s’apparente à celles du Groupe islamique armé (GIA) en Algérie. De plus, les enquêteurs font le parallèle entre l’attentat de Saint-Michel, et l’assassinat – deux semaines plus tôt – de l’imam Sahraoui dans sa mosquée de la rue Myrrha à Paris. Ce cofondateur du FIS, opposé aux actions du GIA contre civils et religieux, partisan de renouer le dialogue avec le pouvoir algérien, aurait été menacé dans la feuille clandestine du GIA, el-Ansar, enjoint d' »interrompre les négociations au nom du Jihad » et de se taire sous peine de mort. Un ultimatum.
Fausse piste. Les services de renseignements, RG et DST, retrouvent dans ce bulletin du 22 juin comme un avertissement : pour « venger les martyrs » tués dans le détournement de l’Airbus à Marseille à Noël 1994, « la France va recevoir prochainement des signes clairs ». Le quotidien algérien la Tribune, bien informé par la sécurité militaire, aiguillait les agents français sur les assassins de Sahraoui, cinq hommes du GIA dirigés par un certain « Abdessabour » qui « repassera aux actes dans les prochains jours ». Un article prémonitoire, huit jours avant Saint-Michel.
Les services français demandent à leurs homologues algériens de décoder le pseudonyme « Abdessabour » et identifient Abdelkrim Deneche, un activiste supposé du GIA basé en Suède. Les photos de Deneche intègrent ainsi les albums de suspects présentés aux témoins. Un gendarme breton qui a vu trois Arabes s’échanger un sac et se congratuler sur le quai à Châtelet, juste avant la déflagration à Saint-Michel, croit reconnaître Deneche. C’est ainsi que le juge antiterroriste Jean-François Ricard, fonce en Suède, le jour même du second attentat dans une poubelle, place de l’Etoile à Paris (le 17 août), pour arrêter ce suspect numéro un. Or, le 25 juillet, Deneche a perçu ses aides sociales dans un bureau de poste de Stockholm, en laissant signature et empreintes sur le reçu, et n’a donc pas pu poser la bombe à Saint-Michel. Fausse route.
C’est une trace de doigt sur l’engin intact retrouvé sur la voie du TGV à Cailloux-sur-Fontaines (Rhône) le 26 août qui aiguille les enquêteurs sur la bonne piste, sur Khaled Kelkal, 24 ans, petit délinquant de la banlieue de Lyon. La police ratisse les milieux islamistes radicaux. Le 7 septembre, un carnage est évité de justesse à Villeurbanne (Rhône), un véhicule piégé explose devant une école juive, juste avant la sortie des élèves.
Revendication. Repéré dans les monts du Lyonnais le 27 septembre, Kelkal s’enfuit, sans son copain Koussa, interpellé. Et, au bout de quarante-huit heures de chasse à l’homme, Kelkal est tué par les gendarmes. Le jour de son enterrement, une bombe explose à Paris au métro Maison-Blanche. Le GIA revendique alors au Caire les « frappes militaires au coeur même de la France », en raison de son « soutien aux apostats » (gouvernement algérien), et révèle l’existence d’une missive secrète à Jacques Chirac sommé de « se convertir à l’islam ». La police surveille toute la bande de Kelkal à Vaulx-en-Velin, et suit ainsi Nasserdine Slimani qui, le 31 octobre, rencontre à Paris l’émir Boualem Bensaïd, alias « Mehdi ». Les policiers ne lâchent plus d’une semelle Bensaïd : il loue un appartement dans le XVIe arrondissement, et téléphone le soir même à Belkacem à Lille pour discuter d’un attentat imminent à la voiture piégée sur le marché Wazemmes de la ville. Le réseau a été aussitôt démantelé, les 1er et 2 novembre 1995, à l’exception du maître d’oeuvre de la campagne d’attentats, Ali Touchent dit « Tarek », qui laisse aujourd’hui son adjoint Bensaïd affronter seul ses juges.
————-
LEMONDE.FR | 01.10.02 |
Ouverture du procès de deux des auteurs présumés des attentats de 1995
Entre juillet et novembre 1995, six bombes explosent à Paris, faisant huit morts et quelque 200 blessés. Attribués au Groupe islamique armé (GIA) algérien, ces attentats visaient la population civile, plongeant la capitale française dans une véritable psychose pendant quatre mois. A partir du 1er octobre, trois de ces six attentats sont au menu de la cour d’assises de Paris. Très attendu par les 200 parties civiles, ce procès, prévu pour durer un mois, est marqué par l’absence pesante d’un des trois accusés. Deux auteurs présumés seulement comparaissent à la barre : Boualem Bensaïd et Smain Ait Ali Belkacem. Les deux hommes de nationalité algérienne, qui ont revendiqué leur appartenance au GIA, ont déjà écopé, en 1999, de trente ans de réclusion criminelle, assortie d’une peine de sûreté de vingt ans, pour Bensaïd, et dix ans d’emprisonnement pour « association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste » pour Belkacem. Ils devront maintenant répondre devant la cour d’assises spéciale – composée de juges professionnels et exclusivement consacrée au terrorisme – de leurs responsabilités respectives dans ces attentats.
Boualem Bensaïd, 34 ans, comparaît, lui, comme auteur principal présumé des attentats à la station RER Saint-Michel (25 juillet, 8 morts et environ 150 blessés) et à la station de métro Maison Blanche (6 octobre, 18 blessés), et comme complice présumé de l’attentat de la station RER Musée d’Orsay (17 octobre, 30 blessés). Smain Ait Ali Belkacem, 34 ans, pour sa part, répondra de la seule mise en place de la bombe de la station Musée d’Orsay.
LE GRAND ABSENT DU PROCÈS
MM. Bensaïd et Belkacem nient la pose des bombes proprement dite. Plusieurs éléments du dossier sont pourtant accablants pour les deux hommes. Parmi eux, des empreintes digitales de M. Bensaïd prélevées sur l’explosif de Maison Blanche, et un coupon de carte orange retrouvé sur M. Belkacem, qui démontre que son propriétaire est sorti de la station Javel, située à trois stations de celle du Musée d’Orsay, quelques minutes avant l’attentat. Quant à la bombe de Saint-Michel, l’accusation s’appuiera sur des notes que les enquêteurs ont interprétées comme des repérages, et sur les accusations d’un autre membre du réseau, pour tenter de prouver la culpabilité de M. Bensaïd. Les deux encourent la perpétuité.
A leurs côtés, dans le box des accusés, une chaise vide : celle de Rachid Ramda, 33 ans, présenté comme le financier du réseau. Il devait être renvoyé avec eux devant la cour d’assises spéciale, mais il est toujours sous écrou extraditionnel à Londres après le refus de la haute cour britannique de le livrer à la France. La cour décidera dès mardi si elle le juge en son absence ou ultérieurement.
Environ la moitié des quelque 200 parties civiles, représentées par SOS-Attentats, devraient assister à l’audience, en marge de laquelle une cellule d’assistance psychologique a été mise en place. Une quinzaine de témoins devraient être appelés à la barre. Si le calendrier de l’audience n’est pas modifié, le verdict est attendu le 31 octobre.
Avec AFP et Reuters
———————–
LEMONDE.FR | 01.10.02 |
Bensaïd et Belkacem nient être impliqués dans les attentats de 1995
Les blessés et familles des victimes des attentats parisiens de 1995 ont rempli mardi la salle d’audience de la cour d’assises spéciale de Paris au premier jour du procès de Boualem Bensaïd et Smaïn Aït Ali Belkacem. Certaines des parties civiles – près de 200 – ont pris place aux côtés de leurs avocats, face aux accusés. Les deux prévenus algériens de 34 ans, barbus, en tee-shirts, sont restés impassibles lors de la lecture des noms des victimes, montrant même leur lassitude ou un certain agacement pendant la lecture des charges retenues contre eux ou à l’appel de la quinzaine de témoins au procès.
Ils ont expliqué à la fin de la séance qu’ils niaient les faits. « C’est la logique qui veut que je conteste. Il y a trop de contradictions dans la lecture des faits », a dit Boualem Bensaïd. « J’ai la preuve que je n’étais pas en France » au moment des faits, a affirmé Ali Belkacem. Depuis la rétractation en 1995 de leurs aveux à la police, les deux hommes affirment être étrangers aux attentats tout en admettant être militants du GIA.
Trois attentats à la bombe du GIA avaient fait 8 morts et 200 blessés à Paris en 1995 : 8 morts et 150 blessés le 25 juillet à la station Saint-Michel du RER, 16 blessés le 6 octobre devant la station de métro Maison-Blanche et 26 blessés le 16 octobre à la station Musée d’Orsay du RER.
Bensaïd et Belkacem encourent la réclusion à perpétuité assortie d’une période de sûreté pouvant aller jusqu’à 22 ans pour « assassinats et tentative d’assassinat en relation avec une entreprise terroriste ».
Bensaïd, présenté comme le « coordinateur » de la campagne d’attentats, est accusé d’avoir posé la bombe de Saint-Michel. Le principal témoin à charge contre lui, Nasserdine Slimani, qui a purgé sept ans de prison pour sa participation à des actes préparatoires des attentats, est cité comme témoin mais ne s’est pas présenté mardi au tribunal. La cour a ordonné à la police de le rechercher pour l’audience du 14 octobre.
Boualem Bensaïd est aussi jugé pour complicité dans le dossier de l’attentat à la station Maison-Blanche. Il purge une peine de trente ans de réclusion prononcée en 2001 pour un attentat manqué contre le TGV Paris-Lyon le 26 août 1995.
Ali Belkacem purge, quant à lui, une peine de dix ans pour « participation à une association de malfaiteurs terroriste ». Présenté comme l’artificier du groupe, il comparaît uniquement pour l’attentat de la station Musée-d’Orsay.
Le dossier de Rachid Ramda, un troisième Algérien présenté comme le financier de la campagne d’attentats et détenu depuis novembre 1995 à Londres, a été disjoint et devrait faire l’objet d’un autre procès. Londres a refusé pour l’instant son extradition.
« UN RISQUE DE REMISE EN LIBERTE » DE RAMDA
Durant la lecture de l’acte d’accusation, Bensaïd a protesté contre la demande de constitution de partie civile d’une « association internationale de victimes du terrorisme », fondée à Alger et jusque-là inconnue.
« Les premiers accusés viennent se constituer en victimes, c’est le monde à l’envers », a-t-il lancé, sous-entendant ainsi que l’association représenterait en fait les autorités d’Alger.
La constitution de partie civile de cette association, qui n’existait pas à l’époque des faits, a été refusée par la cour.
Les parties civiles ont quant à elles ignoré la cellule de soutien psychologique mise en place à leur intention devant la salle d’audience. Devant les caméras, elles ont exprimé leur colère et leur chagrin.
« Tant que je serai vivant, ces gens-là ne sortiront jamais de prison », a affirmé Richard Girier-Dufournier, un policier qui a perdu sa fille de 24 ans, Sandrine, dans l’attentat de Saint-Michel. Lui-même a été victime d’un autre attentat, une bombe placée à la station de RER Port-Royal le 3 décembre 1996, un dossier jamais élucidé.
Mercredi, la cour entame l’examen de l’affaire sur le fond avec l’interrogatoire de l’ancien chef de la police antiterroriste Roger Marion. Bensaïd affirme avoir été frappé par les policiers lors de son interrogatoire.
Concernant Rachid Ramda, Françoise Rudetzki, présidente de l’association SOS-Attentats, a souhaité la tenue d’un procès le plus rapidement possible.
« Il y a un risque de remise en liberté car Rachid Ramda n’est accusé de rien au Royaume-Uni et sa détention de sept ans peut désormais être considérée comme illégale », a-t-elle dit à la presse.
La cour d’assises spéciale, composée de sept magistrats professionnels, a dès le début du procès décidé de disjoindre le dossier Ramda. L’Algérien devrait donc être jugé ultérieurement, à une date qui reste à déterminer, soit par contumace soit en sa présence si Londres accepte de l’extrader.
La High Court de Londres a annulé en juin le feu vert donné par le gouvernement britannique à son extradition, en estimant que Ramda ne pourrait pas bénéficier d’un procès équitable en France. L’examen judiciaire de la demande d’extradition doit reprendre fin novembre.
Avec AFP et Reuters
————————
LE MONDE | 01.10.02 | 11h58
« Elyas » et « Tarek », absents du box mais au cur de l’enquête
Londres refuse d’extrader le premier,
le deuxième aurait été tué en Algérie
Ce sont les deux grands absents du procès qui devait s’ouvrir, mardi 1er octobre, devant la cour d’assises spéciale de Paris : Rachid Ramda, que la justice britannique refuse d’extrader vers la France, et Ali Touchent, déclaré mort par les autorités algériennes en mai 1997. Rachid Ramda se trouve depuis sept ans au cur d’un imbroglio judiciaire dans lequel s’opposent la France et la Grande-Bretagne. La justice française soupçonne cet islamiste algérien d’avoir été le financier de la campagne d’attentats terroristes de 1995. Installé à Londres, Rachid Ramda, dit « Elyas », était chargé de la rédaction et de la diffusion du journal Al Ansar, organe de propagande des Groupes islamiques armés (GIA).La police britannique a découvert un bordereau d’envoi de fonds destinés à Boualem Bensaïd, sur lequel ont été relevées les empreintes de Rachid Ramda. Au cours d’une perquisition à son domicile londonien, des documents établissant ses liens avec les GIA et un disque dur où figurait sa comptabilité ont été retrouvés. Suite à ces découvertes et aux mandats d’arrêt internationaux délivrés par les juges d’instruction, Jean-Louis Bruguière et Laurence Le Vert, Rachid Ramda était placé sous écrou extraditionnel en novembre 1995. Le 20 juin 1996, la justice anglaise autorisait son extradition. Mais le ministère britannique de l’intérieur, qui devait confirmer cette décision, a longtemps tardé. La forte présence des militants islamistes sur le sol anglais semble avoir expliqué ce manque d’entrain.
« IMPATIENCE » FRANÇAISE
Le 8 octobre 2001, le ministre de l’intérieur, David Blunkett, acceptait enfin d’extrader Rachid Ramda, avant que la Haute Cour de Londres ne s’y oppose, arrêtant le processus. Dans sa décision rendue le 27 juin, la Haute Cour mettait en cause la demande d’extradition française, écrite en 1995, où n’auraient pas figuré certains éléments du dossier judiciaire français. Cette absence a fait craindre aux juges anglais que Rachid Ramda n’aurait pas droit à un » procès équitable » en France. Ils s’interrogeaient en particulier sur la régularité des aveux passés par Boualem Bensaïd au cours de sa garde à vue, concernant ses liens avec Rachid Ramda. Ce nouveau contretemps judiciaire a conduit le ministre de la justice, Dominique Perben, à exprimer la semaine dernière son « impatience » vis-à-vis de Londres, en attendant l’examen d’une nouvelle demande d’extradition.
Le nom d’Ali Touchent, alias « Tarek », devrait lui aussi revenir régulièrement dans les débats. Considéré comme le représentant des GIA en France, chargé d’animer les réseaux terroristes et de coordonner la campagne des attentats de 1995, Ali Touchent a toujours échappé aux arrestations. Il aurait été tué le 23 mai 1997 lors d’une fusillade avec les forces de l’ordre à Alger. Il apparaît à plusieurs reprises dans la procédure, tant pour la préparation de l’attentat de Saint-Michel que pour celui d’Orsay.
Lors de la garde à vue qui avait suivi son arrestation en novembre 1995, Boualem Bensaïd avait ainsi déclaré agir sur les instructions de « Tarek ». L’enquête policière avait d’ailleurs fait apparaître qu’il partageait un appartement avec Boualem Bensaïd, boulevard Ornano à Paris (18e) pendant l’été 1995, puis rue Félicien-David (16e). Ali Touchent aurait également été reconnu sur photographie, avec Boualem Bensaïd, par l’employé de l’armurerie où a été achetée la poudre ayant servi à la fabrication de la bombe artisanale de Saint-Michel. Son rôle de coordinateur des attentats semble en outre avoir été confirmé par les fichiers cryptés saisis au domicile de Rachid Ramda en Angleterre, dans lesquels « Tarek » apparaît comme le destinataire des fonds des GIA envoyés en France entre mai et août 1995.
C’est encore à « Tarek » que Boualem Bensaïd en aurait référé avant de perpétrer l’attentat près de la station de métro Maison-Blanche, le 6 octobre 1995, pour « venger » la mort de Khaled Kelkal.
Pascale Robert-Diard et Piotr Smolar
————————
Boualem Bensaïd : un karatéka happé par le djihad
S. D.-S. Le Figaro, 01 octobre 2002
Elevé au sein d’une fratrie de onze enfants, fils d’un commerçant ambulant et d’une mère au foyer, Boualem Bensaïd, 35 ans, n’a manifestement pas bu le lait de l’islamisme forcené dans sa prime jeunesse. Ce n’est qu’au début des années 90 que ce karatéka barbu – il représente l’Algérie dans les compétitions internationales – s’est laissé happer par le discours radical des prêcheurs de djihad. Selon les psychiatres qui l’ont examiné, il ne pourrait pas passer pour un génie du terrorisme. Non qu’il soit sot – son intelligence est » normale » – mais, note un expert, ses » capacités d’abstraction et de conceptualisation ne sont pas développées « . » Ses convictions, ajoute ce médecin, sont répétées dans des formules sommaires, floues et identiques, sans développement discursif ni argumenté. «
Un diagnostic qui cadre avec ce que Boualem Bensaïd a donné à voir lors de ses précédentes comparutions. Il a notamment été condamné à dix ans d’emprisonnement pour » association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme « , et à trente ans de réclusion pour un attentat manqué contre le TGV Lyon-Paris.
Son attitude dans le box des accusés alternait alors entre le retrait et la diatribe. Signe particulier : il ne supporte pas qu’on lui parle de bombe. Lorsque l’avocat général s’y était essayé, il avait essuyé la réplique suivante : » Des bombes ? Vous [les Français] en avez fait exploser partout. En Allemagne à la fin de la guerre, à Mururoa, en Algérie ! Et pour reprendre l’Indochine, vous avez tué tous les Chinois ! » Sans développement discursif ni argumenté
Malgré la douleur, elles témoigneront » pour qu’ils cessent de nier » Les victimes accablées par l’arrogance des prévenus
————————
Smaïn Belkacem :
de multiples identités et aucun remords
S. D.-S. , Le Figaro, 01 octobre 2002
Smaïn Aït Ali Belkacem, 34 ans, est un spécialiste de la fausse identité : il a déjà eu maille à partir avec la justice sous une foule de pseudonymes. Comme Boualem Bensaïd, qu’il connaît et apprécie à l’évidence bien davantage qu’il ne le dit, il a été condamné en 1999 à dix ans de prison pour association de malfaiteurs. Belkacem est né en juillet 1968 près de Blida. Famille de huit enfants, père fonctionnaire. » Certains de ses copains engagés aux côtés du FIS n’en reviendront pas, expliquait dernièrement à l’AFP Me Philippe Van der Meulen, son avocat. Il se tourne vers le GIA, unique opposition armée au régime algérien. Est-il le type même du jeune embrigadé par les cadres du GIA ? Son profil psychologique laisse penser que oui. «
Lorsqu’il comparaît devant le tribunal correctionnel, Belkacem démontre que, comme son comparse Bensaïd, il a le sens de la diatribe : » Vous êtes la voix du Mal ! Nous aimons la mort comme vous aimez la vie « , lance-t-il par exemple à l’assistance.
L’expertise médico-psychologique n’a pas mis en évidence de trouble particulier, révélant seulement une » légère instabilité « .
Dans un box, une telle » instabilité » est de nature à révulser les parties civiles. Smaïn Aït Ali Belkacem n’est poursuivi que pour son implication présumée dans l’attentat du Musée d’Orsay : aucun mort mais trente blessés qui, tous, attendent aujourd’hui une explication et un remords. Il n’est pas sûr que Belkacem soit homme à exprimer l’un ou l’autre.