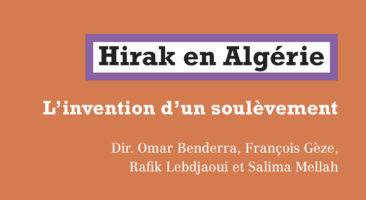«Des exécutions pour faire peur»
Un déserteur raconte les méthodes de la Sécurité militaire algérienne face au GIA:
«Des exécutions pour faire peur»
Arnaud Dubus, Bangkok, Libération, 27 août 2001
Emprisonné depuis cinq mois à Bangkok, Abdelkader Tigha, ancien cadre du DRS (Département du renseignement et de la sécurité), l’ex-Sécurité militaire algérienne, tente d’obtenir un statut de réfugié politique, afin d’éviter d’être refoulé dans son pays d’origine. «Ce serait la catastrophe», considère ce déserteur de l’armée, persuadé qu’il y serait torturé et exécuté. En attendant le résultat de sa requête, actuellement en cours d’appel à Genève, l’ancien chef de brigade du DRS veut «éclairer [s]es interlocuteurs sur ce qui se passe en Algérie». Il raconte son travail au sein du bureau du DRS dans la région de Blida, à une cinquantaine de kilomètres d’Alger, de 1993 à 1997, les années les plus noires de la «sale guerre».
«Exploitations». Tigha, 33 ans, affirme qu’il était chargé «d’identifier, de localiser et d’évaluer le degré d’implication» des sympathisants présumés des Groupes islamiques armés (GIA) dans cette ville, siège de la plus grande région militaire d’Algérie, devenue terre de prédilection des islamistes au début des années 1990. Après quoi, il transmettait les dossiers au service de police judiciaire militaire, chargé des «exploitations» (interrogatoires sous torture systématique) et des exécutions. «L’ordre d’éliminer toutes les personnes interpellées a été donné pendant l’été 1993 par le général Smaïn Lamari, chef de la lutte antiterroriste», affirme-t-il. Il confirme ainsi pour la première fois les informations qui avaient circulé à l’époque, selon lesquelles l’ordre avait été donné de «ne faire aucun prisonnier». Une politique d’éradication décidée, selon lui, à cause de l’influence croissante du mouvement islamiste. Les militants des GIA reformaient leurs réseaux au sein des prisons. A l’extérieur, attaques et attentats d’envergure contre les casernes étaient quotidiens. «Les exécutions visaient à diminuer le recrutement des GIA et à faire peur à la population civile», poursuit le détenu, qui assure n’avoir jamais été directement impliqué dans des liquidations ou dans des séances de tortures.
Une partie du travail de Tigha consistait à superviser l’infiltration des groupes islamiques par des agents «retournés» par son service. «Un sympathisant islamiste est arrêté pour avoir ravitaillé un groupe armé. Il est frappé, torturé, puis libéré. Aux yeux de ses compagnons, il porte les marques de la torture. Mais, en fait, il commence à travailler avec le DRS», raconte Tigha. Ces taupes ont renseigné le service de recherche et d’investigation, la division où travaillait Tigha, sur les cibles futures des GIA, sur les planques des différents groupes armés, quand elles n’incitaient pas ces derniers à commettre des attentats pour retourner l’opinion. Une mission hautement risquée: dix agents «retournés» (sur une soixantaine) ont été assassinés dans la région de Blida entre 1993 et 1997. C’est par ce biais que le DRS «neutralisera» le groupe islamique dirigé par l’émir Hocine Flicha, à Alger. L’agent infiltré approvisionnait le groupe en munitions.
Terreur. C’est dans ces années qu’est apparu l’Ojal (Organisation des jeunes algériens libres). Ce sigle mystérieux était retrouvé sur les cadavres des prisonniers exécutés jetés la nuit sur les routes, parfois devant leur domicile. Tigha est formel: «Cette pseudo-organisation imaginaire» a été créée par un de ses supérieurs. «Cela voulait dire: « Voilà le sort de celui qui travaille avec les GIA. »» Selon Tigha, les exécutions signées Ojal ont été commises par la police judiciaire militaire et les groupes d’intervention spéciale, des unités militaires opérant clandestinement la nuit. Pour casser le soutien de la population aux islamistes et créer la terreur.
Fin 1996, Tigha est chargé par son service d’établir un rapport d’enquête sur la disparition de Mohamed Boularas et de Mohamed Rosli, deux profs d’université proches des GIA dont on est sans trace depuis 1994. Le rapport, qui implique la police judiciaire militaire, déplaît aux supérieurs de Tigha, muté à Alger, qui doit restituer son arme de service. Il comprend le message. Début 1999, il s’enfuit clandestinement en Tunisie, puis en Thaïlande, où il est arrêté, son visa expiré.
Tigha se dit prêt à témoigner devant un tribunal pénal international. Nombre de ses collègues aimeraient l’imiter, «mais ils n’ont pas les moyens de sortir». Aujourd’hui, son cas pose un problème au Haut-Commissariat aux réfugiés des Nations unies, qui considère ne pas pouvoir lui accorder le statut de réfugié du fait de sa possible implication dans des «crimes contre l’humanité». «Mais il est inconcevable qu’il soit refoulé dans son pays, la protection contre la torture étant un droit absolu», dit son avocate. Même dans sa cellule, Tigha dit craindre pour sa sécurité et réclame une «protection physique».
Encadré: Défections en augmentation
Les défections au sein des forces de sécurité algériennes ne sont pas nouvelles. Des policiers, les premiers, ont témoigné il y a déjà plusieurs années sur les exactions commises à leur niveau pendant la «sale guerre». Mais ce sont les dénonciations des militaires dissidents montrant l’implication des forces de l’ordre dans des tueries de civils qui inquiètent le plus les autorités. Ecurement face à une guerre fratricide qui n’en finit pas, refus de continuer à faire le sale travail pendant que la haute hiérarchie de l’armée se déchire pour le partage de la rente pétrolière, fissures dans la chaîne de commandement militaire… Depuis des mois, les défections de militaires de tous grades se multiplient.