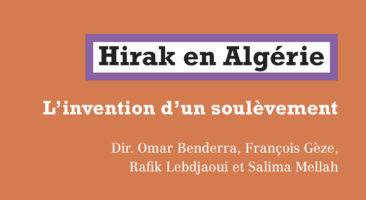Bab El Oued, 8 mois après
HUIT MOIS APRÈS
Quest Bab El-Oued devenu?
L’Expression, 5 août 2002
Un jour de novembre 2001, après plusieurs mois de sécheresse, des pluies diluviennes dune rare violence ont surpris ce quartier dans la torpeur matinale.
Venues des hauteurs de Bouzaréah et dEl-Biar, les eaux en furie ont dévalé la route à double voie de Frais-Vallon, charriant tout ce quelles rencontraient sur leur passage: la terre rendue friable par des années de sécheresse, les troncs darbre, les pneus et les matériaux de construction entreposés de part et dautre de la route.
Tous ces objets nont fait que décupler la vitesse et la dangerosité du torrent de boue auquel plus rien ne résiste : ni les véhicules, emportés comme des fétus de paille avec leurs passagers désemparés, ni les vieilles bâtisses, qui cèdent et sécroulent sur leurs habitants, ni les êtres humains, qui ne peuvent opposer aucune résistance aux éléments déchaînés, et périssent noyés.
Isolement
Mais arrivées au niveau de Bab El-Oued, les eaux tumultueuses sont stoppées dans leur élan par les bâtiments érigés, de façon trop rapprochée, sur le lit même de loued. Empêchées ainsi de suivre le tracé naturel de leur course, elles en deviennent plus dangereuses et le nombre de victimes augmentera sensiblement.
Ce que peu de gens savent en fait, cest que si le torrent de boue est arrivé à Bab El-Oued vers 9h, il avait pris au moins une heure davance dans les autres localités situées à lest de Bab El-Oued, sur laxe Raïs Hamidou-Aïn Bénian, et ce, tout simplement parce que la forêt de Baïnem est plus proche du front de mer que ne lest Bouzaréah de Bab El-Oued.
A 8h déjà, les véhicules légers et lourds étaient pris dans les pièges de boue et la route était pratiquement coupée tous les cent mètres environ, y compris pour les piétons qui ne pouvaient affronter la colère des crues impétueuses. Lorsque les eaux étaient stoppées par une quelconque construction, elles trouvaient immédiatement le moyen de la détourner et de poursuivre leur course folle vers la mer. Dès les premières heures de la catastrophe, il fallait parer au plus pressé en essayant de sauver le maximum de vies humaines, mais hélas, on ne pouvait repêcher que les cadavres. Le nombre de décès ne fera quaugmenter dheure en heure. Beaucoup étaient difficiles à identifier. Les proches devaient aller les récupérer à la morgue dEl-Alia, où lémotion le disputait parfois aux scènes les plus poignantes et les plus tragiques. Et en ce mois de Ramadan, les familles sinistrées, qui avaient trouvé refuge dans les centres de transit, devaient faire montre de beaucoup de patience pour ne pas laisser voir leur colère.
Sur tout laxe Bab El-Oued-Aïn Bénian, en plus des routes coupées et des maisons effondrées par endroits, il fallait également affronter dautres désagréments: pas délectricité, pas deau ni même de gaz par endroits. Les boulangeries et les épiceries étaient pour la plupart fermées, soit parce quelles étaient inondées, soit parce quelles ne pouvaient fonctionner à cause du manque dénergie, soit parce quil ny avait plus de farine pour fabriquer le pain.
Les pannes délectricité et de téléphone accentuaient cette impression disolement et de catastrophe. Non seulement on navait ni télévision ni journal pour se tenir informés, mais on ne pouvait même pas entrer en contact avec les proches ou les amis de travail pour leur donner des nouvelles ou leur demander de laide. Les gens se débrouillaient comme ils pouvaient pour sapprovisionner. Le prix du paquet de bougies était passé à cent dinars.
Mais cétait le moindre mal, car la plupart des familles pouvaient sestimer heureuses que le toit ne leur soit pas tombé sur la tête et quaucun de leurs membres nait péri. Il suffisait de faire le dos rond et attendre le retour des jours meilleurs, surtout que ceux qui avaient une radio et qui avaient pu se débrouiller des piles étaient plutôt catastrophés, les bulletins météorologiques ayant annoncé le mauvais temps et de nouvelles intempéries.
En revanche, la situation était dramatique lorsque la vie était en jeu ou lorsque les murs de la maison sécroulaient ou menaçaient de le faire. Les sinistrés, entassés dans les écoles et les centres de transit, en savaient certainement quelque chose et en ont gardé un souvenir indélébile. Fort heureusement, la solidarité nationale et internationale a été formidable. Et malgré quelques points noirs, notamment le détournement de dons aussitôt dénoncés par la presse et les sinistrés eux-mêmes, on a vu affluer des secours de tous les coins dAlgérie et du monde. Il y eut même beaucoup de gestes symboliques de générosité et de dons durant toute cette période. Malheureusement, vu limportance des dégâts causés par la catastrophe, il fallut plus de dix jours pour dégager la voie sur laxe Raïs Hamidou-Aïn Bénian, et cela a mis encore beaucoup plus de temps au niveau de Bab El-Oued, localité la plus touchée, vu le surpeuplement, la densité, la vétusté des constructions et le nombre de victimes (entre morts, disparus et sinistrés).
Et à présent, neuf mois après les intempéries, où en est-on? Et peut-on faire le point sur les mesures qui ont été prises pour assurer le retour à la vie normale?
Le doyen des élus
Pour avoir des réponses à ces questions, nous avons demandé audience au président de lAPC de Bab El-Oued.
Professeur dhistoire et directeur dun établissement scolaire, Abderrahmane Ben Amar est maire depuis huit mois, cest-à-dire depuis les inondations du 10 novembre. Auparavant, il était vice-président de lAPC. Il en est à son troisième mandat. «Je suis ici depuis 1985, avoue-t-il, et on peut dire, si je ne mabuse, que je suis le doyen des élus au niveau de la wilaya dAlger, bien que je sois relativement jeune. Par la volonté de Dieu, jai été amené à gérer la crise induite par les inondations du 10 novembre 2001.» Nous apprendrons de sa bouche que Bab El-Oued est un mouchoir de poche, puisque lagglomération, qui ne sétale que sur une superficie de deux kilomètres carrés, compte une population officiellement recensée de 96.000 habitants.
Mais on sait que ce chiffre ne reflète pas la réalité, puisque, selon les estimations, Bab El-Oued renfermerait facilement plus de 130.000 âmes, sans compter les gens de passage. Sachant que tous les cinquante ans environ il faut refaire une ville, on peut considérer que le tissu urbain de Bab El-Oued est largement dépassé. Les bâtiments sont vétustes et les moins anciens ont plus de 130 ans. «Au début de notre mandat, dans les années 80, on avait un projet avec lOpgi de Dar El-Beïda.» La convention signée entre les deux parties prévoyait que toutes les constructions à un étage seraient remplacées par des bâtiments de plusieurs étages. Pendant la période des travaux, les habitants seraient relogés à Dar El-Beïda. Ils auraient eu le choix soit de revenir à Bab El-Oued sous certaines conditions, soit de rester à Dar El-Beïda.
Mais ce projet na pu aboutir à cause de problèmes internes à lAPC de Bab El-Oued. Linstabilité des équipes et la non-continuité ont eu raison de ce beau projet.
Parallèlement, il y a les bâtiments qui menacent ruine depuis le séisme de 1989. Il en a été dénombré 180. Les techniciens du CTC sont venus, ils ont fait leur expertise; et dans leur rapport, il est dit que ces bâtiments doivent être démolis. Depuis cette date, les responsables de la mairie ont rasé 49 constructions et le programme de démolition est toujours en cours. «Cest un programme qui est géré par la wilaya dAlger, dont les moyens sont très limités, notamment dans le domaine du relogement.»
On rase, on démolit, on reconstruit, tout cela se fait-il selon un plan urbain préétabli ou bien dans la plus totale anarchie? «Justement, avoue Ben Amar, ce sont les inondations qui ont fait prendre conscience de la nécessité de respecter la topographie de Bab El-Oued, qui était à lorigine le lit dun oued.»
Partant de ce fait, les services techniques de la wilaya ont élaboré un nouveau plan urbain en prenant en compte cette donnée fondamentale de sorte à éviter à lavenir une nouvelle catastrophe comme celle du 10 novembre, y compris dans vingt, trente ou cent ans.
La violence sauvage des inondations a surpris tout le monde, y compris les spécialistes en météorologie, mais il ne fait aucun doute que les constructions agglutinées les unes contre les autres érigées sur le lit naturel de loued ont contribué à en amplifier leffet destructeur et meurtrier.
Arrivés au niveau de Bab El-Oued, ces alluvions et torrents de boue nont pas trouvé dissue vers la mer, et une bonne partie sest infiltrée dans les caves des bâtiments et sest répandue avec force dans les rues adjacentes.
Les rues Rachid-Kouache et Berrazouane ainsi que le marché de Triolet ont été submergés.
Ahmed BEN-ALAM