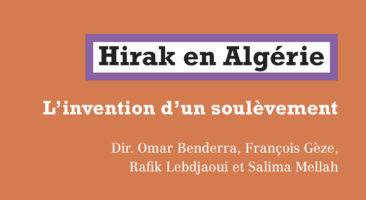31 ans après le coup d’État : l’Algérie entre crise interne et crises externes
Omar Benderra, Algeria-Watch, 11 janvier 2023
Algeria-Watch a pour usage de marquer le sinistre anniversaire du coup d’État militaire du 11 janvier 1992 par des échanges d’idées ou des textes d’analyse de la situation générale de l’Algérie au regard des droits humains, de l’état des libertés publiques et privées ainsi bien entendu que des questions économiques et sociales. Ces trois dernières années, du fait de l’irruption du Hirak en février 2019, ont permis d’envisager sous un angle nouveau l’évolution de la société algérienne, l’action du régime politique qui dirige le pays, les difficultés et contraintes mais aussi les attentes et espérances de la société pour un avenir meilleur.
Le Hirak a en effet permis de dépasser les constats d’impasse et de régression assumés par le régime et d’envisager des perspectives positives de sortie de l’interminable crise dans laquelle se débat le pays depuis cette date, effectivement fatidique, du 11 janvier 1992. Cette année 2023, celle du trente et unième anniversaire du putsch contre la volonté populaire librement exprimée dans les urnes, s’ouvre dans un environnement international instable en évolution rapide. Sans que cela atténue le moins du monde le poids des responsabilités d’un système d’oppression totalement stérile, cette sombre commémoration se déroule dans une réalité dominée par des enjeux stratégiques, globaux et régionaux, dont les implications pour la place du pays dans le concert des nations et son devenir sont décisives.
La guerre en Ukraine et la fin du monde unipolaire
Le déclenchement de l’« opération militaire spéciale » russe contre l’Ukraine le 24 février 2022 remet en question l’ordre mondial installé de facto depuis la dislocation de l’URSS en 1991. La domination occidentale sur le reste de la planète est ainsi directement contestée par un État disposant de moyens militaires et politiques considérables. Dans une phase historique où l’unipolarité occidentale est de moins en moins acceptée par des pays qui, malgré leurs dimensions stratégique, économique et démographique, restent maintenus à la périphérie des centres de décisions globaux. La création du BRICS en est une des manifestations les plus explicites. Cette dynamique qui concerne des pays fort différents dans leurs organisations politiques et leurs structures économiques est perçue comme une menace par les États-Unis qui, estimant leurs intérêts stratégiques mis en question par l’apparition de concurrents décidés à défendre les leurs, a lancé depuis longtemps des manœuvres politiques pour contrer ces adversaires potentiels. L’instrumentalisation du nationalisme ukrainien pour contrer la Russie et du séparatisme taiwanais face à la Chine en sont deux illustrations éloquentes. Ainsi, les tensions croissantes entre ce que Samir Amin appelait la Trilatérale – Union européenne, Japon sous la conduite des États-Unis – d’une part et l’alliance sino-russe d’autre part, aboutissent à une confrontation directe entre l’armée russe et l’armée ukrainienne, massivement perfusée par les États-Unis et leurs alliés.
La question des frontières ouest de la Russie, héritage de l’ère soviétique, et celle de l’expansion vers l’est européen de l’Otan, abcès de fixation des relations du bloc occidental avec la Russie, est donc en voie d’être tranchée par les armes. Il ne s’agit nullement d’un coup de tonnerre dans un ciel d’été même si les médias occidentaux dans un élan très unanime représentent la Russie comme l’agresseur ou l’envahisseur, coupable exclusif du drame en cours. La réalité est, bien entendu, plus nuancée. L’histoire récente, amplement documentée, atteste que la paternité du conflit est certainement partagée par tous ses protagonistes, même si le déclenchement des hostilités est le fait objectif de la Fédération de Russie.
Mais malgré pressions et mises en garde, la grande majorité des pays membres de l’ONU refuse de prendre parti. La déploration par le bloc occidental du non-respect des « règles » par la Russie et la condamnation de sa conduite en matière d’annexion territoriale ne sont guère convaincantes. L’indignation outrée de ces pays prête à sourire quand on la met en perspective avec leur attitude, entre complaisance et complicité, face notamment à l’expansionnisme colonial israélien. En l’espèce, il ne s’agit guère évidemment de valeurs ou de principes, il s’agit bien d’une guerre hybride globale pour la répartition du pouvoir et des ressources de la planète.
Dans le camp occidental, peu de voix se font entendre pour demander que des négociations soient lancées afin que cesse une effroyable effusion de sang. Au contraire, la fourniture de matériels de guerre, d’importance croissante, au régime de Kiev semble être l’unique option.
Pour beaucoup, cette guerre est une nouvelle étape dans la compétition pluridimensionnelle de plus en plus aiguë qui oppose ceux qui bénéficient d’une hégémonie mondiale pluriséculaire à des puissances émergentes qui aspirent à s’asseoir à cette table magistrale. Car le conflit actif en Ukraine ne masque pas une autre zone de tension grandissante, en mer de Chine méridionale et dans le détroit de Taïwan. L’irrésistible montée en puissance économique et militaire de la Chine suscite l’opposition croissante des États-Unis et de leurs alliés. Perçu comme le « rival systémique » par excellence, Pékin est de plus en plus clairement représenté non plus seulement comme un concurrent mais comme un adversaire, allié stratégique de la Russie de surcroît. Ainsi, il ne s’agit plus d’une guerre purement européenne, l’aide militaire dévolue à Kiev dans sa guerre contre Moscou est considérée comme partie du dispositif de containment du binôme Russie-Chine. L’Ukraine apparait comme l’un des théâtres de la confrontation globale entre les partisans de l’unipolarité occidentale et les forces émergentes qui la contestent.
Les effets de la guerre en Ukraine sur l’Algérie : renversement d’alliances ?
L’évaluation des conséquences possibles de cette confrontation influe donc décisivement sur l’analyse de la situation générale du pays. L’Algérie fait en effet partie de ces nombreux pays qui refusent obstinément de s’insérer dans l’un des camps en présence d’un conflit qui n’est pas le sien. Cette posture à équidistance des belligérants est conforme aux intérêts bien compris du pays et à sa tradition établie de non-alignement. Dans les faits, l’Algérie est clairement sous pression, de moins en moins subliminale, pour réduire sa coopération avec Moscou, son principal fournisseur d’armements. De manière très inhabituelle, des démarches diplomatiques des États-Unis en direction de l’état-major de l’ANP sont publiquement entreprises à cette fin.
Il n’est pas nécessaire de faire preuve d’une attention particulièrement soutenue pour observer la succession rapprochée ces dernières semaines d’interviews d’experts, d’articles de presse et d’éditoriaux peu favorables au régime dans la presse occidentale. La dénonciation des violations des droits de l’homme et du déficit démocratique, tout à fait réels, qui suit l’appel à des sanctions contre l’Algérie par un groupe d’élus américains en septembre 2022, n’est guère probante. L’objectif de cette campagne médiatique d’opportunité est bien d’amener Alger à réviser sa position de neutralité et à se ranger dans le camp occidental.
Mais l’Algérie pourrait-elle changer d’allié stratégique ? Dans une telle hypothèse, quelles conséquences en découleraient ? L’expérience de pays ayant opéré un tel revirement montre que changer de fournisseur d’armements est un exercice extrêmement complexe et coûteux préjudiciable au maintien du niveau opérationnel des armées. Dans le contexte régional actuel incertain, l’affaiblissement des moyens de dissuasion militaire stimulerait les manœuvres de déstabilisation dans l’environnement immédiat, sahélien et libyen, tout en alimentant les velléités du Makhzen, très soutenu par ses alliés du Golfe et son partenaire militaire israélien…
Au plan politique, la rupture avec les alliés traditionnels s’accompagnerait de concessions, l’abandon de l’opposition au colonialisme et du non-alignement, que le régime ne peut accepter à moins de renier le legs fondamental de la Révolution algérienne. Les « décideurs » n’ignorent pas qu’un tel renversement d’alliances pourrait se révéler éminemment contre-productif comme ont pu le mesurer les dirigeants syriens et le colonel Kadhafi. En s’éloignant de ses partenaires de longue date pour se rapprocher des Occidentaux, le régime libyen n’a fait que précipiter sa chute.
Du contexte global au contexte régional : l’ennemi aux portes
Les répercussions de l’intervention de l’Otan en 2011 contre le régime de Mouammar Kadhafi continuent de caractériser un contexte régional dominé par l’insécurité et la déstabilisation. La Libye en guerre civile et le Sahel en proie à une crise violente constituent autant de foyers de tension et de menaces potentielles pour la sécurité nationale. À cette donne déjà ancienne s’ajoute l’apparition aux frontières ouest du pays d’éléments de l’armée israélienne qui confère une dimension supplémentaire aux développements militaires du Makhzen. La coopération avec Tel-Aviv a été fortement relancée par le rétablissement des relations diplomatiques en décembre 2020, dans le sillage des « accords d’Abraham » supervisés par l’administration Trump. Même si, en réalité, Rabat n’avait jamais vraiment coupé ses canaux de communication avec Israël en dépit de la rupture formelle des relations diplomatiques dans les années 2000.
En échange de cette « normalisation » et en violation du droit international, les Etats-Unis reconnaissent la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, revendiqué par le Front Polisario au nom du peuple sahraoui. Madrid, opérant un revirement à 180°, a reconnu en mars 2022 le plan marocain d’autonomie du Sahara et s’est aligné sur la position américaine, suivie par Berlin au cours de l’été 2022. Ces mouvements diplomatiques favorables aux thèses coloniales du Makhzen semblent avoir conforté ses dispositions militaristes. La fréquence soutenue de manœuvres militaires avec des armées extracontinentales, les achats massifs d’armements, peu médiatisés mais bien réels, et la multiplication des incidents et provocations au Sahara occidental sont autant de manifestations de l’état d’esprit qui prévaut au sommet du Makhzen.
De manière plus significative, la normalisation avec Israël a impulsé une inquiétante dynamique aux relations entre les armées des deux pays, illustrée par la densité des échanges et visites de dirigeants militaires de haut rang. Ces échanges sécuritaires concernent la coopération en matière de renseignement et vont de la production au Maroc d’armes israéliennes à l’installation d’une base commune à Nador, en passant par des exercices militaires conjoints. L’Algérie, dernier pays du défunt « Front du refus » encore debout, est une cible naturelle pour Israël qui considère ce pays comme un obstacle dans sa politique de liquidation de la cause du peuple palestinien. Les accusations de coopération du Front Polisario avec le Hezbollah libanais et celles qui portent sur une alliance stratégique entre Alger et Téhéran viennent à point nommé justifier l’action d’Israël par Makhzen interposé. Les déclarations provocantes dirigées vers l’Algérie par des officiels israéliens à partir du Maroc, celles du ministre israélien Yaïr Lapid en aout 2021 à Rabat en particulier, ajoutent de la substance à la menace.
La monarchie, qui ne peut donner de leçon à quiconque s’agissant de corruption, d’inégalités et d’autoritarisme, joue sur le sentiment national de la société marocaine en encourageant les thèses expansionnistes, présentant son voisin de l’est comme l’ennemi irréductible, spoliateur des intérêts du pays. Conforté par ses soutiens diplomatiques et son partenariat militaire avec Israël, le Makhzen n’est pas à l’abri de la tentation d’une aventure pour consolider son emprise.
L’opinion algérienne, plutôt bien informée grâce aux ressources du net et aux réseaux sociaux, n’ignore rien de ces dangereuses gesticulations. Il ne fait guère de doute que, bien au-delà du régime, c’est le pays lui-même qui est visé. La position stratégique de l’Algérie, la taille d’un territoire aux ressources largement inexploitées entre Méditerranée et profondeur africaine peuvent attirer les mêmes convoitises que celles qui ont fini par emporter la Libye voisine. De plus, et ce n’est pas la moindre des considérations, l’élimination du challenge politique représenté par une société profondément imprégnée des valeurs de résistance et de justice permettrait d’unifier la région dans un régime de soumission à l’impérialisme et aux forces néocoloniales.
Crises externes, crise interne
Mais le danger structurel qui pèse sur la cohésion politique de l’Algérie réside dans le régime lui-même. De fait, entre répression et incompétence, la dictature a, au vu de tous, atteint un degré de sénescence tel qu’il affecte le fonctionnement du pays en décourageant toutes les initiatives, en bâillonnant toutes les voix dissonantes et, au final, en démoralisant une jeunesse qui ne trouve aucune perspective dans un pays bloqué. Sans légitimité et sans relais dans la société, la direction de régime ne peut qu’assumer une fuite en avant dans la corruption et la brutalité.
La répression qui altère l’image de l’Algérie en Europe est un gage d’obédience aux monarchies golfiques alarmées par le Hirak et qui craignent par-dessus tout la contagion démocratique. Les arrestations d’activistes, de jeunes qui ont l’audace d’exprimer leurs opinions sur les réseaux sociaux et de journalistes, la fermeture de médias professionnels, sont autant de signes d’impuissance devant une société qui aspire à se débarrasser de l’arbitraire, à s’exprimer et s’organiser librement. L’Algérie traverse bien, sous des formes différentes, la même crise depuis le 11 janvier 1992.
Face à une population qui lui a très massivement signifié leur illégitimité, leurs expédients politico-médiatiques ayant fait long feu, les « décideurs » n’ont plus pour leviers que la rente des hydrocarbures et la répression. En effet, le modèle élaboré par les laboratoires de la police politique, associant classe politique préfabriquée, société civile artificielle et presse agréée, n’opère plus. Le discrédit moral et politique dont sont frappés les relais de l’action psychologique est aggravé par la qualité régressive des personnels chargés de les animer. Il n’est que d’évoquer l’étonnement de nombre de citoyennes et de citoyens, qui ne se berçaient pas d’illusion mais ont été cependant interloqués par le niveau affligeant des premiers ministres et ministres se succédant à la barre lors des procès-règlements de compte dans les mois ayant suivi l’éviction d’Abdelaziz Bouteflika en 2019. Depuis lors, au vu des sorties publiques des figures de proue bureaucratiques actuelles et de la production des médias autorisés, tout porte à croire que le niveau général de l’encadrement du régime s’est davantage dégradé…
Il reste cependant qu’en dépit de ses dérives, le système militaro-sécuritaire a conservé une partie des éléments du patrimoine politique accumulé durant la guerre de libération : la souveraineté et la défense de l’intégrité territoriale. Ces principes directeurs demeurent, vaille que vaille, des références de l’action extérieure officielle du régime et participent de l’un des rares domaines où peut être observée une convergence d’appréciation politique des « décideurs » et de l’opinion.
La société, dont de larges catégories sont durement confrontées à une situation économique et sociale extrêmement difficile, suit de près les évolutions et fait preuve d’une authentique capacité de discernement quant aux priorités de l’heure. Les crises externes et leurs répercussions possibles sont perçues avec acuité. En effet, les Algériennes et les Algériens ; loin d’être indifférents aux dangers véhiculés par la guerre en Europe, considèrent qu’au contraire des surenchères, la recherche de la paix devrait être l’objectif premier de toutes les parties concernées. L’exigence d’une vigilance renforcée, requise par l’aggravation des conditions de l’environnement géostratégique immédiat, est partagée par le plus grand nombre.
Les militants et activistes du Hirak, et plus largement l’opinion publique, n’ont cessé de réitérer le pacifisme et la non-violence de la mobilisation politique pour le droit et les libertés. La conscience politique aiguisée du peuple identifie précisément les milieux, à l’intérieur et à l’extérieur du pays, qui visent l’Etat de tous les Algériens. Trente et un ans après le putsch antinational, le mouvement profond de la société, proclame avec force la solidarité avec les luttes décoloniales, en Palestine et au Sahara-Occidental, et exprime la constance du soutien populaire aux principes agissants du non-alignement.