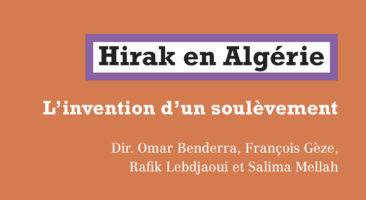Tragédie humaine et effondrement économique en 2020 : Retour lent à la normale en 2021
Abdelrahmi Bessaha, El Watan, 28 décembre 2020
Cet article va d’abord faire le bilan de la situation économique et structurelle au niveau mondial et de l’Algérie, analysera les grands défis qui se profilent, discutera des perspectives en 2021 et fera des propositions.
Introduction
Alors que 2020 tire à sa fin, beaucoup d’entre nous ne peuvent pas attendre la fin de cette annus horribilis. Et pour cause : un virus apparu en Chine en janvier s’est propagé à travers le monde pour se transformer à partir du 11 mars en une pandémie prenant tous les gouvernements du monde par surprise. A ce jour, la pandémie a causé la contamination de 78 millions de personnes ; la mort de plus de 1,7 million de personnes dans le monde ; un effondrement économique bien supérieur à celui de la crise financière de 2008 ; un débordement de ressentiment contre des décennies d’injustice raciale et sociale ; et un nombre record de catastrophes naturelles (incendies de forêt décimant des millions d’hectares de forêts vierges ; invasions de criquets aux conséquences tragiques pour de nombreuses populations, inondations, etc.,).
Pourtant, 2020 nous donne aussi des raisons d’espérer. Le développement, en quelques mois seulement, d’au moins deux vaccins qui promettent un haut degré d’efficacité est tout simplement miraculeux : un grand triomphe de la médecine, de la technologie et de la mondialisation. Considérez à quel point la découverte et la distribution de ces vaccins auraient été impossibles sans l’échange trans-frontalier d’idées, de biens et de services. Entre les laboratoires de recherche, les chercheurs ainsi que les tests et la fabrication (y compris les divers matériaux auxiliaires tels que les flacons et seringues en verre et les réfrigérants spéciaux), au moins une douzaine de pays ont participé au développement et à la production de ces vaccins.
La fin de cette année tragique nous donne une opportunité de faire un bilan de ce qui a été fait au plan international, des changements à moyen et long terme que la pandémie ne manquera pas d’induire et des perspectives pour 2021 qui, d’après les experts, sera une année d’un retour lent à la normale. Pour ce qui est de l’Algérie, en plus de la pandémie, le pays a subi un choc pétrolier particulièrement violent car il a touché non seulement la demande mais également l’offre. De plus, ces deux chocs sont intervenus dans un contexte de déséquilibres majeurs dus à une mauvaise gestion du choc pétrolier de 1986.
Les dommages occasionnés sont multiples et les politiques publiques mises en place pour faire face aux risques n’ont pas été à la hauteur des défis. Faute de réformes, les perspectives pour 2021 restent défavorables du fait de nombreuses contraintes, dont un budget mal conçu.
L’économie mondiale en 2020, annus horribilis
En plus de la tragédie humaine (soulignée par les chiffres ci-dessus), la pandémie a infligé des dommages économiques, financiers, sociaux et mentaux considérables (dont certains prendront des années à surmonter) et a exacerbé les déséquilibres structurels qui minaient l’économie mondiale avant ce choc sanitaire.
Pour le premier point, quelques chiffres pour situer l’ampleur du coût de cette pandémie :
(i)- une hausse marquée du chômage qui touche, selon une étude internationale, environ 150 millions de travailleurs (affectant durement les jeunes, les femmes et les travailleurs à faible revenu) ;
(ii)- une montée considérable de la pauvreté affectant 90 millions de personnes (selon le FMI), effaçant en quelques mois tous les progrès accomplis au cours des 20 derniers années ; et
(iii)- une détérioration de la santé mentale de millions de personnes à travers le monde. Ces coûts auraient pu être plus élevés sans les interventions des autorités publiques (pour contrer les effets du confinement et de la fermeture de pans entiers de l’économie, seules armes pour lutter contre la pandémie) à travers deux canaux.
(1)- Le canal budgétaire avec le déploiement de plans de relance (12,000 milliards de dollars de dépenses) pour fournir des compléments de revenus (transferts monétaires, subventions salariales et allocations chômage ciblées), un soutien aux entreprises vulnérables mais viables affectées par le confinement (reports d’impôts, moratoires sur le service de la dette et injections de capitaux sous la forme de prises de participation) et pour les grands pays avancés, le financement d’investissements dans la recherche et le développement de traitements et de vaccins ; et
(2)- le canal monétaire avec des injections massives de liquidité de la part des grandes banques centrales pour un montant de 2300 milliards de dollars. Grâce aux mesures d’appui ci-dessus, le PIB mondial devrait, d’après le FMI, reculer de 4,4%, au lieu des 5,2% prévus initialement en juin.
Repartis par région, les programmes de relance budgétaire et monétaire ont permis d’atténuer les reculs de la croissance économique aux Etats-Unis (-4,4% au lieu de -4,9%), dans la zone euro (-8,3% au lieu de -10,2%) et en Chine (1% au lieu de -1,9%). Les pays en voie de développement fragiles enregistreront a contrario, pour leur part, une chute de croissance plus élevée (-1,2% au lieu de -1%), creusant ainsi l’écart entre les deux groupes de pays. Ces efforts budgétaires colossaux ont, toutefois, aggravé la dette souveraine qui représente désormais 100% du PIB mondial.
La pandémie a exacerbé les déséquilibres structurels
de l’économie mondiale
Notons :
(1)- le découplage entre le secteur financier et le secteur réel entretenu par deux facteurs :
(i)- le premier étant le rôle démesuré pris par les banques centrales dans la gestion des crises (du fait du manque de courage politique des autorités à prendre des mesures difficiles sur le plan budgétaire) ; et
(ii)- les profits considérables réalisés par le secteur financier du fait précisément des politiques monétaires ultralibérales, profits réinvestis en son sein plutôt que dans les infrastructures et l’innovation. La preuve du caractère nocif de la financiarisation est fournie par la crise financière de 2008, déclenchée en grande partie par des placements spéculatifs dans les secteurs immobilier et financier qui ont généré des bulles et le surendettement des ménages ;
(2)- la poursuite de gains à court terme de la part des grandes entreprises (pour retenir la confiance des bourses et distribuer des dividendes) au détriment d’investissements à long terme, notamment dans le secteur des énergies vertes, accélérant ainsi le réchauffement de la planète et privant l’économie mondiale de ressources importantes vitales pour augmenter son potentiel de croissance ;
(3)- l’implication limitée et tardive des Etats au niveau des secteurs sociaux une fois constatée la défaillance des marchés ; et
(4)- l’alourdissement de la dette des entreprises pour faire face à l’érosion de la demande. Focalisées sur les seuls gains à court terme, ces entreprises se sont retrouvées en grande difficulté en l’absence de stratégies à long terme qui les auraient aidés à faire face aux effets dévastateurs de la pandémie.
Le monde est en train de changer progressivement sur les plans économique, géostratégique, climatique et même au niveau de la doctrine macroéconomique
Cinq tendances qui se profilaient avant la pandémie émergent avec intensité et vont certainement imprimer leur marque sur la recomposition de l’économie mondiale. Notons ainsi.
(1)- Les technologies de l’information et de la communication qui vont continuer de peser sur notre style de vie et nos façons de travailler. Grâce aux communications modernes à bande large, associées à zoom et à des logiciels de visioconférence similaires, des millions de personnes ont pu continuer de travailler à domicile. Cette façon de travailler va survivre à la fin de la pandémie et pourrait même devenir une norme de travail dans de nombreux secteurs ;
(2)- les inégalités : en gestation depuis deux décennies, elles se sont aggravées à la faveur de cette pandémie. Si de nombreux employés de bureau (généralement bien rémunérés) ont eu la possibilité de travailler à domicile, ce n’est pas le cas de nombreux autres travailleurs appartement généralement à des minorités et occupant des emplois non qualifiés. Ces disparités sont évidentes au sein de chaque pays avancé et davantage entre pays développés et pays en développement. Elles constituent un frein à la prospérité des pays ;
(3)- Le recours massif à l’endettement de la part des états, des entreprises et des ménages pour financer leurs besoins (endettement facilité par des taux d’intérêt extrêmement bas). En conséquence, la part de la dette brute mondiale par rapport au PIB est passée de 321% à la fin de 2019 à 362% à la fin de juin 2020 (Institut for international finance). Même si les taux d’intérêt nominaux et réels sont très bas, le surendettement constitue un facteur de risque futur pour les états et les entreprises ;
(4)- le renforcement de la mondialisation à l’échelle régionale. La pandémie qui a plongé l’économie mondiale dans une récession va sans conteste accentuer à court terme le mouvement de ralentissement de la mondialisation en cours du fait de la rareté des opportunités, de l’absence de libéralisation du commerce mondial et de la montée du protectionnisme. En revanche, il ne faut pas exclure une montée des regroupements régionaux (comme en témoigne le récent accord sur le plus grand partenariat régional des 15 pays membres de la région Asie-Pacifique) et des ajustements modestes au niveau des chaînes de valeur mondiales (rapatriement d’une gamme très limitée de produits, dont ceux jugés très sensibles). Par contre, aucun mouvement de réarmement tarifaire exceptionnel n’a eu lieu (les autorités préservent l’avenir, conscientes de l’effet dévastateur de telles mesures sur leurs perspectives de croissance économiques) ;
(5) – les tensions politiques : en hausse du fait de l’érosion de la crédibilité de la démocratie libérale, de la résurgence du courant nationaliste dans certains pays et de la montée en puissance de la Chine sur la scène mondiale ;
(6)- les transformations géostratégiques induites par un puissant mouvement de décarbonisation ;
(7)- l’évolution de la pensée macroéconomique marquée par une remise en question des anciennes orthodoxies macroéconomiques, notamment celles relatives aux dépenses publiques, au déficit budgétaire, à l’inflation et l’emploi (courbe de Phillips qui fait un arbitrage entre les deux variables), aux banques centrales, aux taux d’intérêt et à l’intervention de l’Etat dans l’économie ; et
(8)- la réhabilitation sous une forme moderne de l’intervention économique de l’Etat, sous la forme d’une politique industrielle et d’une planification moderne.
Les perspectives macroéconomiques mondiales pour 2021 restent prudentes vu le contexte d’incertitudes extrêmes
Le monde fait face à beaucoup d’incertitudes. Pour ce qui est des signes positifs, notons :
(1) – le rebond constaté au cours du troisième trimestre au niveau des trois pôles de croissance (grâce aux plans de relance et injections de liquidité) ; et
(2)- les récentes avancées majeures en matière de vaccins qui suscitent l’espoir d’un retour à la normale au cours des 12 prochains mois.
Parmi les signes négatifs, retenons :
(1)- la seconde vague de contaminations
(en cours) :
(2)- l’apparition éventuelle d’une troisième vague à la mi-janvier 2021 ; et
(3)- la faiblesse de la coopération internationale – incontournable – pour soutenir une économie mondiale dynamique, préserver la paix et gérer les biens communs mondiaux. Dans un tel contexte, une hystérésis (persistance) des inégalités au niveau du marché du travail, creusant davantage les inégalités et renforçant la pauvreté. A moins que la dynamique de la pandémie ne change de manière significative dans les mois à venir, un facteur à ne pas exclure, l’activité économique devrait se redresser plus lentement que prévu. Ainsi, en 2021, la croissance économique mondiale se situerait aux environs de 5,2%, dont 3,9% pour les pays avancés, 6% pour les pays émergents et en développement et 4,9% pour les pays en développement à faible revenu.
Algérie : De l’illusion de la prospérité générée par le boom pétrolier à la super crise dont la gestion reste en deçà des défis
Deux questions importantes se posent, notamment l’évaluation objective de la gestion des deux chocs de mars 2020 et bien entendu les perspectives pour 2021. Pour ce qui est de la première question, les éléments d’analyse sont les suivants :
(1)- L’Algérie a subi deux chocs violents qui ont heurté frontalement une économie fortement déséquilibrée du fait de la mauvaise gestion du choc pétrolier de 2014. En effet, les autorités de l’époque avaient à tort privilégié le financement de la crise économique au détriment d’une stratégie d’ajustement et de réformes viables et crédibles, option d’autant plus aisée à mettre en œuvre que le pays disposait de ressources importantes à cet effet (à fin 2013, les RIC s’élevaient à 192,4 milliards de dollars (3 ans d’importations) et une épargne financière de 5563 milliards DA logée au niveau du FRR) ;
(2)- Les chocs extérieurs ont fortement aggravé les déséquilibres budgétaires et extérieurs, déclenché une série de crises sectorielles, conduit à une récession, mis à nu la non-viabilité du modèle rentier (pour autant que des doutes subsistaient) et mis sur la table la question stratégique de la gouvernance politique, économique et sociale ;
(3)- La sortie de la récession sera longue, complexe, nécessitera un savoir-faire et exigera des mesures fortes et cohérentes avec un suivi méticuleux au niveau de la phase de mise en œuvre. Pour l’heure, les réponses en place restent largement en deçà des défis colossaux. La gestion de crise a été faible tant sur le contenu que sur la méthode ;
(4)- Les politiques publiques mises en œuvre en 2020 sur le plan budgétaire, monétaire et social ont eu un impact limité pour des raisons de conception et de capacité.
(i)- Sur le plan budgétaire, le plan de relance adopté en juin 2020 dans le contexte de la loi de finances complémentaire (LFC) pour 2020 est ineffectif, en raison de 3 facteurs. Tout d’abord, le montant de 70 milliards DA (soit 0,32% de PIB ou 1,4 % des dépenses courantes budgétisées dans la LFC 2020) est modeste pour encourager la consommation privée (50 % du PIB en 2019). En second lieu, avec un multiplicateur de dépenses courantes de 0,6% pour l’Algérie, ces 70 milliards DA ne pouvaient induire que 420 millions DA de dépenses courantes additionnelles, un montant insignifiant pour produire des effets sur la demande. En troisième lieu, sur les 70 milliards DA de dépenses totales, seuls 56 milliards DA avaient un ciblage approprié pouvant influencer la demande à court terme ;
(ii)- sur le plan monétaire, la faiblesse du canal de transmission de la politique monétaire, la capacité technique limitée au niveau du système bancaire et la faible inclusion financière sont autant de contraintes réduisant l’efficacité les mesures monétaires accompagnant la relance budgétaire et les mesures d’appui aux entreprises ; et
(iii) – pour les mesures sociales en direction des couches vulnérables de la société, leur efficience a été amoindrie par l’absence de données permettant un ciblage optimal.
(5)- De façon similaire, la LFI 2021 manque d’ambition et n’a pas la capacité à compenser les défaillances du plan de relance de la LFC 2020. Pourquoi ?
(i)- le budget 2021 est bâti sur des hypothèses de croissance irréalistes (4% du PIB total en 2021 par rapport à un recul du PIB de 4,6% en 2020 et 2,4% du PIB hors pétrole en 2021 par rapport à une contraction de 4,5% en 2020). L’objectif de croissance du PIB en 2021 implique une amélioration de 8,6 points de pourcentage en 2021. Or, l’économie algérienne ne dispose pas de ressorts solides pour faire un tel bond de croissance en si peu de temps vu les rigidités structurelles qui contraignent l’économie, la faiblesse des mesures correctives prises pour combattre la pandémie, la montée du chômage et de la pauvreté, la faiblesse de demande, les difficultés des secteurs productifs publics et privés et l’absence de financements non monétaires. En second lieu, le montant global de 52,3 milliards DA (0,3% du PIB et 1% du volume total des dépenses courantes budgétisées) est trop modeste pour agir de façon décisive sur l’activité économique et in fine le niveau de vie de la population ;
(ii)- le multiplicateur de dépenses courantes est de 0,6%, n’entraînant ainsi qu’environ 310 millions DA de dépenses additionnelles, un montant modeste pour générer un impact marquant.
(6)- A ce jour, la communication publique, outil incontournable de gestion de crise, a été un échec total, privant la population d’informations capitales sur la nature des problèmes et la feuille de route.
(7)- La transparence a été également un point faible dans la gestion de la crise. A l’exclusion du premier trimestre 2020 (pré-datant la pandémie), les données de base sur les finances publiques, les comptes monétaires, la balance des paiements et le secteur réel ont disparu des sites officiels. Cette dissimulation de données économiques n’a aucune justification et est absolument incompréhensible sauf à vouloir empêcher la population de s’informer. En ce sens, elle va à l’encontre des principes élémentaires guidant la gestion des affaires publiques.
(8)- une gestion de crise défaillante. Le modus operandi de la gestion de la crise actuelle est similaire à celui qui a été suivi pour faire face aux chocs pétroliers de 1986 et 2014. Prenant confort des niveaux des réserves internationales de change, les mesures correctives ont un caractère partiel, prises en dehors d’un plan global cohérent, ce qui limite ipso facto leur portée et aggrave la crise. Cette gestion des crises est révélatrice de nombreux facteurs, dont l’absence de stratégie de développement à long terme (qui favorise l’empirisme), la fragmentation de la décision économique, l’absence de coordination et surtout le marque de capacité institutionnelle de gestion de crise qu’elle soit monétaire, financière ou économique. Un savoir-faire en matière de gestion de crise implique des cadres institutionnels bâtis sur :
(i)- la détection des signaux de crise ;
(ii)- la préparation de mesures cohérentes dans un cadre global à moyen terme ;
(iii)- un sequencing des mesures sur le moyen terme ;
(iv)- la continuité dans l’effort de réforme quitte à recalibrer les mesures mais non le «stop and go» ;
(v)- la communication régulière ; et
(vi)- la transparence ainsi que la diffusion à échéance régulière des données macro-économiques de base.
Non sans surprise, la projection des principaux indicateurs à fin 2020 soulignent la détérioration de la situation macroéconomique et confirment la gravité de la crise. Pour 2021, les perspectives restent défavorables
En 2020, le tableau macro-économique qui prend forme est le suivant :
(1) – un recul de la croissance réelle d’environ 5-6% ;
(2)- une remontée de l’inflation des prix à la consommation de 3,5% -4,5% ;
(3)- un déficit budgétaire de 15,3% du PIB ;
(4)- un déficit du compte courant de la balance des paiements de 16,3% du PIB ; et
(5)- une baisse des réserves internationales de change (50 milliards de dollars à fin septembre 2020) à environ 42,8 milliards de dollars. Pour 2021, l’Algérie va l’entamer avec des déséquilibres macroéconomiques significatifs, une myriade de crises sectorielles et l’absence de stratégie de réformes.
Dans ce contexte, en tendance actuelle, le cadre macroéconomique serait le suivant :
(1)- une croissance négative de – 6% ;
(2)- une inflation des prix à la consommation de 5,5% ;
(3)- un déficit budgétaire de 14,1% du PIB ;
(4)- un déficit du compte courant de la balance des paiements de 16,3% du PIB ; et
(5)- une baisse des RIC à environ $23,8 milliards. Un niveau de RIC largement en dessous des besoins annuels du pays. Une crise de change en gestation a moins d’une dynamique nouvelle du marché pétrolier.
Les gaps de financement pour la période 2021-2023 seront considérables
En tendance actuelle, en dehors de toute réforme, le déficit budgétaire global se situerait en moyenne à 14% du PIB. Tandis que celui du compte courant de la balance des paiements serait de 16% du PIB.
En conséquence, les besoins de financement prévisionnels pour 2021-2023 seront :
(1)- pour le budget, environ 2200 milliards DA/an soit 6600 milliards DA (soit environ 50 milliards de dollars) ; et
(2)- pour la balance des paiements, environ 60 milliards de dollars. Le total des besoins de financement est de total de 110 milliards sur trois ans. Si des réformes sont mises en place, il est à attendre un gain cumulatif de 25 milliards de dollars. Combiné aux disponibilités en réserves de change internationales d’environ 42,8 milliards de dollars à fin 2020, le gap de financement restant à couvrir sera donc de 42 milliards sur 3 ans. Comment financer ce gap ? L’endettement intérieur auprès des ménages, des banques et des compagnies d’assurance est à exclure. Ces agents économiques ont été frappés par la récession. Une marge de manœuvre limitée existe au niveau de la finance islamique locale à condition de pouvoir la mobiliser. La part la plus importante du gap ne peut être couverte que par des financements extérieurs, mobilisables auprès :
(1)- des créanciers officiels multilatéraux ;
(2)- des institutions régionales de développement ;
(3)- des partenaires bilatéraux pour appuyer le financement des projets et/ou apporter de l’aide budgétaire ;
(3)- des grandes banques pour obtenir des crédits syndiqués ; et
(4)- du marché financier international pour placer des obligations souveraines internationales. Compte tenu de l’ampleur des besoins, de l’absence de stratégie de sortie de crise et des limites de nos ressources, les bailleurs de fonds vont comme de coutume conditionner leurs contributions à la conclusion d’un programme avec le FMI, lequel sert de caution aux partenaires étrangers, notamment pour ce qui est du remboursement de leurs créances.
Pour l’heure, il est urgent de prendre des mesures urgentes pour assurer la visibilité à moyen terme du pays afin d’affronter la récession, assurer l’adhésion des citoyens et tenter de modifier la trajectoire qui nous conduit vers un ajustement contraint: Pour ce faire, le pays doit :
(1)- se doter des outils de pilotage suivants même à titre intérimaire :
(i)- une vision à long terme ;
(ii)- une stratégie à moyen terme ; et
(iii)- un cadre budgétaire à moyen terme qui serait assis sur des objectifs à moyen terme (2021-2023) destines à renforcer autant que faire se peut l’espace budgétaire du pays et préserver les RIC ;
(2)- développer une politique de communication : fondamentale en période de crise afin de traiter des causes fondamentales autant que des symptômes afin de calmer les craintes de la population, faciliter la compréhension des défis et obtenir l’adhésion des citoyens à des mesures qui pourraient être difficiles à mettre en œuvre. Les messages devront être simples, en veillant à:
(i)- ne laisser aucune question essentielle sans réponse ;
(ii)- exposer les grandes orientations des autorités ;
(iii)- ne pas occulter les faits désagréables pour contrer la rumeur, les spéculations et les exagérations qui viendront combler les lacunes de l’information officielle ; et
(iv)- parler d’une seule voix pour éviter des contradictions ou un manque de cohérence dans les messages ; et
(3)- publier les données macro-économiques de base en temps opportun et assurer la diffusion leur plus large. Les crises, aussi sévères soient-elles, ne sont pas des fatalités. Elles se gèrent.
Par Abdelrahmi Bessaha
Macroéconomiste, spécialiste des pays en post-conflits et fragilités