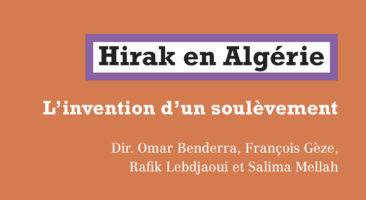Suppression de l’article 87 bis : Les gestionnaires exigent des compensations
par Ghania Oukazi, Le Quotidien d’Oran, 2 février 2014
La suppression de l’article 87 bis a buté contre des résistances qui ont failli compromettre le principe de son acceptation par le gouvernement.
«L’hypothèse de travail consiste à donner une nouvelle définition à la notion du SNMG pour pouvoir remplacer l’ancienne,» écrit l’UGTA dans le document qu’elle compte exposer lors de la prochaine tripartite. Document inclus dans le rapport du groupe tripartite qui s’est chargé d’examiner le thème en question. Elle en trace la trame et propose cette équation «SNMG=traitement de base =18 000 dinars.» Ce qui doit obliger les pouvoirs publics à procéder à un réajustement des salaires de base de certaines catégories à ce niveau du SNMG fixé, pour rappel, en 2012. La mise en œuvre de l’équation syndicale au niveau des institutions et administrations publiques consiste, selon les explications des responsables de l’UGTA, «à relever le traitement de base des catégories 1 à 8 à 18 000 DA. «Cela aura un impact financier estimé à 76 120 222 455 milliards de DA,» souligne la Centrale syndicale. Les effectifs (toutes catégories confondues) qui seront concernés par le réajustement de leur salaire de base, sont de l’ordre de 1 000 790 employés.
Au-delà de cette incidence financière, l’UGTA prévient en outre, que «l’application de cette mesure aura des contraintes majeures comme l’inversement du système de hiérarchie de la rémunération et le tassement des rémunérations entre les catégories.» Il en résultera en plus, selon les responsables syndicaux, la destruction du système de qualification sur lequel repose le fondement du système de rémunération de la fonction publique. «Un titulaire d’un diplôme de technicien sera rémunéré au même niveau qu’un agent ayant le niveau de 6ème année fondamentale,» préviennent-ils.
La redéfinition du SNMG entraînera, selon eux, la destruction du système de carrière qui est aussi des fondements sur lequel repose la fonction publique. C’est-à-dire, expliquent les syndicalistes, qu’elle obligera à «l’abrogation du système de formation ainsi que la promotion par le mérite.» Elle remettra en cause et détruira par ailleurs «le système de rémunération qui a été mis en place avec la grille indiciaire des traitements et le nouveau régime indemnitaire depuis 2008.» En fait, c’est un bouleversement total de toute la politique salariale du pays et des instruments de son application. Mais la Centrale syndicale anticipe et conseille «une sortie de crise», afin, disent ses responsables, «de maintenir les équilibres et la cohérence du système de rémunération en place, ainsi que l’éventail des niveaux de rémunérations.» Elle propose «d’accompagner la nouvelle définition du SNMG par des mesures correctives nécessaires qui consistent au relèvement des salaires par le biais du doublement de la valeur du point indiciaire (VPI) (…).» Ce qui ne sera pas non plus sans incidences financières. Le relèvement du VPI aura, selon ses calculs, un impact financier lourd sur le budget de l’Etat estimé à 1 461 774 136 763 milliards de DA pour un effectif global des administrations publiques (tous grades confondus) de 1 777 443 d’employés.
Le réajustement des salaires conformément à une nouvelle définition du SNMG fait d’ores et déjà jaser les gestionnaires des divers secteurs d’activités. Ils agitent d’emblée le spectre des licenciements puisque, disent la plus part d’entres eux, «il nous obligera à augmenter la masse salariale.» Ils exigent alors «une compensation financière des caisses de l’Etat.» Compensation financière pour, soutiennent-ils, «pouvoir faire face aux augmentations en évitant les licenciements.» Encore une fois, la Centrale syndicale «innove» et suggère «une diminution des cotisations à charge des patrons.» Il semble que le compromis a été accepté «par tous les partenaires sociaux.» Une diminution des charges sociales «d’un point» est qualifiée d’«appréciable» voire «d’énorme» et permet, soutiennent les responsables de l’UGTA, de compenser les pertes financières attendues de la suppression du 87 bis au niveau de l’ensemble des secteurs d’activités. Il est clair que le processus enclenché n’est ni simple ni applicable tout de suite même si l’abrogation du 87 bis est désormais acquise. Une fois tout le volet technique et financier clarifié, le gouvernement devra présenter au parlement la loi 90-11 relative aux relations du travail, appelées aussi lois sociales (incluant le Code du travail).
Ceci, pour abroger l’article en question de ladite loi. «Ce n’est qu’à partir de là qu’on pourra combiner avec la loi de Finances pour y consacrer légalement les besoins financiers du réajustement des salaires de base,» nous explique un membre du gouvernement.
Faillite d’un Etat, rééchelonnement de la dette et ajustements Structurels : Genèse de l’article 87 bis
par G.O.
Les discussions sur la suppression de l’article 87 bis ont été engagées et retenues durant les travaux de la tripartite qui s’est tenue en septembre 2011.
Les partenaires sociaux se sont alors accordés à mettre en place un groupe de travail qui devait en évaluer les incidences financières. En effet, à entendre le gouvernement et l’UGTA, le principe de la suppression de l’article en question a été retenu dès que la proposition a été faite. «Le 87 bis est abrogé mais c’est la faisabilité technique qui pose problème, » nous dit-on à l’UGTA. Les discussions amorcées depuis 2011, le sont donc pour peser la masse d’argent qui devra en compenser «les manques à gagner» à la Fonction publique et au secteur économique, ou plutôt qui devra leur permettre d’en supporter les nouvelles dépenses. Pour en comprendre l’ensemble de ces effets, il faut rappeler en premier la définition de l’article 87 et les conditions qui ont poussé le gouvernement à lui accoler quelques années plus tard, le fameux 87 bis. «Le salaire national minimum garanti (SNMG) applicable dans les secteurs d’activités est fixé par décret, après consultation des associations syndicales de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives, » stipule l’article 87 de la loi 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations du travail parue dans le JO n°17 du 25 avril de la même année. Pour la détermination du SNMG, il est tenu compte, lit-on dans un document récent de l’UGTA (janvier 2014), de «l’évolution de la productivité moyenne nationale enregistrée, de l’indice des prix à la consommation, de la conjoncture économique générale. » Cette définition est inspirée de la loi 78-12 du 5 août 1978 relative au Statut général du Travailleur paru dans le JO n°32 du 8 août de la même année. Les syndicalistes notent aussi que «la rédaction de cet article répond aux critères de fixation des salaires minima, notamment en ce qui concerne les pays en voie de développement, préconisés par la convention 131 de l’OIT (article 3) et la recommandation 135-II.3. » L’une dans l’autre, ces références précisent que les critères relatifs à la détermination des salaires minima doivent reposer sur « les besoins des travailleurs et de leur famille, le niveau général des salaires dans le pays, le coût de la vie et ses fluctuations, les prestations de sécurité sociale, les niveaux de vie comparés à d’autres groupes sociaux, les facteurs d’ordre économique, y compris les exigences du développement économique, la productivité et l’intérêt qu’il y a à atteindre et à maintenir un haut niveau d’emploi.»
EXIGENCE DU FMI ET «ASTUCE» ALGERIENNE POUR DIMINUER LES SALAIRES
Cette «politique» salariale a été appliquée jusqu’au jour où les gouvernants ont été contraints de reconnaître que le pays croulait sous le poids des dettes contractées auprès de pays étrangers et d’institutions financières internationales. L’absence de vision, la gabegie et le défaut d’anticipation en matière de gouvernance notamment économique, ont été les causes principales d’une telle situation chaotique. Le pays devait non seulement payer ses dettes mais se soumettre aux exigences de ses créanciers. Le Fonds monétaire international (FMI) lui avait ainsi élaboré un tableau de rééchelonnement de ces dettes, accompagné de conditions drastiques. Les discussions sur le rééchelonnement avaient commencé au début des années 90 sous le gouvernement de Redha Malek. Et l’exécution de ses lots de plans d’ajustements structurels (PAS) sous celui de Mokdad Sifi.
Le monde du travail et les familles moyennes et défavorisées du pays en ont payé les conséquences. Fermetures d’entreprises et suppressions d’emplois massives, le FMI en a fait des conditionnalités parmi tant d’entres que l’Algérie devait exécuter sans rechigner. Il avait demandé une baisse des salaires de 50%, une autre de 100% pour les niveaux des retraites ainsi que la suppression de 200 000 emplois. Il fallait donc s’y résoudre à défaut de se faire taper sur les doigts par les institutions de Bretton Woods. A cette même période, le peuple algérien négociait quotidiennement son droit à la vie en faisant face à des hordes de criminels qui voulaient lui imposer leur diktat. L’Algérie avait basculé dans la violence et le crime. Les partenaires sociaux, ou du moins de ce qu’il en restait, cherchaient la manière la moins dure pour faire admettre une baisse de salaires à des travailleurs et des familles terrorisés.
L’ARTICLE 87 BIS A «TITRE TRANSITOIRE»
«Durant la période transitoire qu’a connue notre pays, et compte tenu des difficultés que nous traversions, l’analyse et l’appréciation des préoccupations d’ordre économique et social engendrant une crise multidimensionnelle profonde que vivait le pays en cette étape douloureuse et particulière de son histoire –terrorisme-trésorerie négative-négociations avec le FMI-, l’UGTA a été volontaire pour contribuer aux efforts de redressement de l’économie dans le cadre des mesures d’ajustements initiés par le programme de stabilisation négocié avec le FMI, par l’acceptation de la modification de la structuration du salaire en intervenant sur la définition du SNMG par l’ajout d’un article 87 bis, » expliquent ses responsables. «Le salaire national minimum garanti, prévu à l’article 87, comprend le salaire de base, les indemnités et primes de toute nature à l’exclusion des indemnités versées au titre de remboursement de frais engagés par le travailleur, » stipule l’article 87 bis ajouté par le décret législatif 94-03 du 11 avril 1994 (signé par Liamine Zeroual) modifiant et complétant la loi 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations du travail. L’application de cet article a aidé donc à faire baisser les salaires d’une manière « déguisée » comme le dit l’UGTA. L’indexation des indemnités au salaire de base a bridé à ce jour leur évolution puisque toute augmentation du SNMG devait désormais reposer sur l’ensemble des indemnités qui, elles, sont imposables. « Ce qui est donné d’une main, est récupéré de l’autre, » ironise un législateur. A cette date, le gouvernement a aussi cédé devant le FMI pour diminuer le niveau des retraites de 75% (non de 100% comme exigé.) C’est ce que les syndicalistes appellent « des mesures de solidarité pour aider l’Etat à sortir des griffes du FMI. » Etat qui, faut-il le répéter, avait failli sur toutes les lignes de la gouvernance. Depuis que les gouvernants se targuent d’avoir préservé les équilibres macroéconomiques du pays, d’avoir d’importantes réserves de change, d’avoir parachevé le paiement de la dette extérieure rubis sur l’ongle, financent en même temps les gros investissements publics et augmentent les salaires avec des effets rétroactifs sans précédent et sans se soucier d’une quelconque production, l’UGTA pense que rien n’oblige aujourd’hui à garder l’article 87 bis. «Cette mesure courageuse a été prise à titre transitoire pour faire face à la conjoncture de l’époque et où il a été convenu de la reconsidérer en temps opportun des jours meilleurs, » avait noté la Centrale syndicale lorsqu’elle avait accepté l’exigence du FMI de faire baisser les salaires des travailleurs algériens. Les conditions qui permettent de supprimer l’article 87 bis sont bien réunies. Le pays vit «des jours meilleurs», selon les gouvernants et la Centrale syndicale.