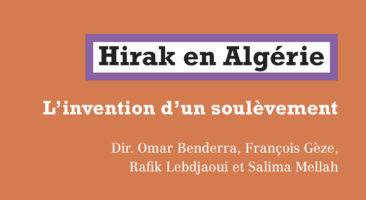Algérie, 2016 : révélations sur le rôle de Yacef Saâdi, héros de la « bataille d’Alger » de 1957
Algeria-Watch, 12 avril 2016
Soixante ans après, dans l’Algérie de 2016, les braises des années brûlantes de la guerre d’indépendance sont toujours ardentes. En a témoigné notamment la très étonnante controverse sur le rôle dans cette guerre de l’ancien militant du FLN Yacef Saâdi, qui a occupé pendant quelques semaines, en début 2016, la une des médias arabophones et francophones algériens, à l’occasion d’une énième querelle aux ressorts obscurs entre lobbies du pouvoir. Une bagarre médiocre, voire grotesque dans ses excès, mais très révélatrice en revanche de l’importance des événements occultés et enfouis qu’elle a remis en lumière. En l’occurrence ceux de la « bataille d’Alger » de l’année 1957, tournant essentiel de la guerre de libération engagée trois ans plus tôt. Des événements sur lesquels Algeria-Watch est en mesure d’apporter une utile contribution, en divulguant ici des documents de premier ordre, pour la plupart inédits, issus des archives de l’armée française.
La « rumeur Yacef Saâdi » : il aurait tout dit aux paras de Bigeard en 1957
De quoi s’agit-il ? L’affaire était ainsi rapportée par le quotidien francophone El Watan le 20 janvier : « Après le dossier de la décennie noire, c’est au tour des symboles de la guerre de Libération nationale de faire l’objet de ce qui s’apparente à une campagne sans précédent dans un climat politique général des plus délétères. Des documents de l’armée française publiés par le quotidien arabophone Ennahar révèlent les déclarations de Yacef Saâdi et Zohra Drif-Bitat sur l’organisation du FLN pendant la Révolution, après leur arrestation. […] Un document estampillé “secret” par les autorités coloniales françaises, daté du 8 octobre 1957, mis en ligne depuis quelques jours et repris opportunément, à dessein, par une chaîne de télévision privée et son site web, fait fureur. Yacef Saâdi et Zohra Drif, des héros de la lutte de Libération nationale, des légendes vivantes de la Bataille d’Alger, sont devenus, par la grâce de vulgaires détours que l’on veut faire jouer à l’histoire, des “traîtres”. […] Bien que le document mis en ligne – racontant ce qui s’apparente à des confessions des deux moudjahidine arrêtés en 1957 –, sorti bien évidemment des archives coloniales, ne renseigne en rien de plus les autorités françaises qu’elles n’en connaissaient déjà sur les leaders de la Révolution, sa divulgation ou son exploitation obéit par contre à une volonté manifeste de punir des personnalités qui ont fini par se rebeller contre la gouvernance chaotique du chef de l’État, Abdelaziz Bouteflika1. »
Une analyse assez plausible, mais à vrai dire sans grand intérêt. Car l’essentiel de ce que révèle ce misérable épisode est ailleurs : il atteste surtout des dégâts provoqués dans la vie politique algérienne par l’instauration, dès l’indépendance, d’une « histoire officielle » occultant ou falsifiant nombre d’événements qui ont façonné la société tout au long des cent trente-deux années de la colonisation française, avec ses sept années finales et terribles de la guerre d’indépendance (1954-1962)2.
Dans l’installation de cette histoire officielle, Yacef Saâdi, né en 1928, occupe une place singulière. Tout jeune chef (vingt-neuf ans) de la Zone autonome d’Alger (ZAA) du FLN, il a été arrêté par les parachutistes français du 1er REP le 24 septembre 1957 (en même temps que la militante Zohra Drif). Et depuis lors, la rumeur n’a cessé de courir en Algérie : il aurait alors livré des informations cruciales à ses geôliers sur l’organisation du mouvement nationaliste, sans même avoir subi de tortures comme ses compagnons d’armes. Pour échapper à la « question » et sauver sa peau, Yacef Saâdi aurait dénoncé les membres du réseau qu’il dirigeait. En particulier son adjoint Ali Ammar (dit « Ali la Pointe »), tué le 9 octobre avec Hassiba Ben Bouali, « Petit Omar », Mahmoud Bouhamidi et d’autres moudjahidines dans l’explosion de sa cache par les parachutistes de Massu. Condamné à mort par la justice française, sa peine est commuée un an plus tard et il sera libéré après les accords d’Évian du 18 mars 1962.
L’histoire officielle et le fameux film de Gillo Pontecorvo La Bataille d’Alger (1966), produit par Yacef Saâdi (il y joue son propre rôle), ont popularisé une image de gloire nationale, de héros. Malgré ce passé glorieux, Yacef Saâdi a disparu des radars après l’indépendance. Il n’a exercé aucune fonction officielle et, à part l’incursion cinématographique déjà évoquée, il ne fait plus parler de lui. Il s’est fait discret durant plusieurs décennies en se livrant au « business » comme certains autres acteurs de la guerre de libération. Il ne réapparaît aux yeux du public qu’au début des années 1990, quand il est appelé à la rescousse par des autorités débordées pour tenter de ramener le calme à la Casbah, secouée par de violentes émeutes. Son intervention n’a rencontré alors qu’une indifférence sourdement hostile. Son prestigieux passé n’a été d’aucune utilité à Yacef Saâdi : la population en colère a chassé le vieux héros. Ce manque de considération populaire a surpris nombre d’observateurs, impressionnés par le passé illustre mis en avant par le récit officiel.
Après les terribles années de la « sale guerre », on le voit réapparaître publiquement à l’été 1999, à l’occasion d’une scène assez étonnante. Abdelaziz Bouteflika, qui vient d’être placé à la tête du pays par les « décideurs » de l’ombre, est au stade du 5 juillet pour remettre la coupe d’Algérie de football. Les objectifs des caméras de télévision sont tournés vers la tribune officielle, ou l’habituelle coterie de flagorneurs et de laudateurs s’agite autour du chef d’État fraîchement intronisé. Soudain un homme se précipite sur Bouteflika, se penche profondément, comme pour une courbette, et se saisit de sa main pour l’embrasser. La scène est vue par des millions d’Algériens incrédules. L’homme en question est Yacef Saâdi. Quelque temps après cet épisode sidérant, surgi d’un autre temps et tout à fait étranger aux mœurs locales, le courtisan sera désigné sénateur par Bouteflika.
« Nous n’avons pas eu besoin de lui mettre une claque, il nous a dit tout ce qu’il savait… »
Curieusement, resté muet pendant plus d’un demi-siècle sur le soupçon vivace concernant son attitude après son arrestation de septembre 1957, Yacef a été particulièrement prolixe sur ses vieux jours pour médire de ses compagnons d’armes. À l’occasion de plusieurs sorties médiatiques, il a décrié plusieurs figures du FLN et pas des moindres. Ainsi, en avril 2011, il a accusé l’ancienne moudjahida Louisette Ighilahriz, torturée par les paras de Massu et Bigeard à l’automne 1957, de faire partie des « menteuses qui excellent dans l’art de faire de la comédie » et de n’avoir eu « aucun rapport avec la guerre de révolution3 ». Puis, en janvier 2014, il a accusé Zohra Drif d’avoir « vendu » Ali la Pointe (en s’appuyant sur des documents qu’elle dénoncera comme des faux)4. Avant d’affirmer, deux mois plus tard, que Larbi Ben M’hidi, assassiné en mars 1957 par les mêmes paras et qu’il avait remplacé à la tête de la ZAA, n’a « pas tiré un seul coup de feu durant la guerre de libération », dans le but évident de minimiser le rôle de cet illustre dirigeant du FLN ; et qu’Ourida Medad, une autre moudjahida, n’est pas « morte en martyre », mais « a préféré se suicider au moment où des soldats français s’apprêtaient à la violer5 ».
Avant cette salve d’accusations aussi incertaines que leurs motivations, Yacef Saâdi s’était toutefois bien gardé de répondre aux révélations très précises sur son rôle à l’époque, faites en 2003 et 2004 par la journaliste française Marie-Monique Robin, dans un documentaire télévisé puis dans un livre6. À l’issue d’une enquête rigoureuse, lors de laquelle elle avait interrogé aussi bien Yacef Saâdi lui-même que certains des anciens paras français qui avaient participé à son arrestation, elle en avait expliqué les circonstances.
Elle racontait ainsi comment le capitaine Paul-Alain Léger, ancien d’Indochine et « expert redoutable de la guerre psychologique », avait créé à Alger en juin 1957 un Groupe de renseignement et d’exploitation (GRE), chargé d’organiser une « action souterraine de rebelles retournés et réinjectés dans le circuit ». Et comment, le 6 août 1957, la compagnie du capitaine Raymond Chabanne avait arrêté Hacène Ghendriche, alias Zerrouk, l’un des adjoints de Yacef Saâdi. Retourné par Chabanne et Léger, ce dernier leur permettra d’infiltrer la hiérarchie la ZAA, tandis qu’une enquête parallèle conduira quelques semaines après à l’arrestation de Yacef Saâdi et Zohra Drif.
La suite de l’enquête de 2003 de Marie-Monique Robin sur l’attitude de Yacef après son arrestation par des officiers français lors de la bataille d’Alger mérite d’être citée précisément : « “Nous n’avons pas eu besoin de lui mettre une claque, m’assure Yves de La Bourdonnaye [membre du GRE à partir de l’été 1957], qui remplaçait Léger, alors en permission, [Yacef] nous a dit tout ce qu’il savait…” “Regardez, me confirme Raymond Chabanne, j’ai conservé les procès-verbaux de ses auditions, avec sa confession libre. Grâce à lui, nous avons pu reconstituer toute l’organisation régionale du FLN.” Et d’exhiber une note de service classée “très secret”, qui présente “deux documents établis d’après les déclarations de Yacef Saâdi, et donnant le schéma de l’organisation politique de la région et l’organisation de la commission financière régionale”. “Et Ali la Pointe ?” “C’est grâce à Zerrouk, alias Safi, dont Ali la Pointe ne savait pas qu’il travaillait pour Léger, que nous avons pu remonter jusqu’à sa cache…” »
En bref, selon les témoignages de ces deux officiers français, Yves de La Bourdonnaye et Raymond Chabanne : a) ce n’est pas Yacef qui leur aurait révélé la « planque » d’Ali la Pointe ; b) mais il leur aurait permis, sans « une claque », de « reconstituer toute l’organisation régionale du FLN ». Pour autant, peut-on prendre pour argent comptant les affirmations de ces deux hommes, tous deux âgés de 79 ans quand Marie-Monique Robin les a recueillis en 2003 ? Le document « secret » de l’armée française du 8 octobre 1957, intitulé « Confession de Yacef Saâdi et de Drif Zohra » et « révélé » par le quotidien arabophone Ennahar en janvier 2016 apporte-t-il vraiment du neuf à ce propos ?
En fait, comme l’a opportunément relevé El Watan7, ce document avait déjà été publié (vraisemblablement en 2011) sur son site Web par l’Association des amis de Raoul Salan8, le général putschiste de 1961 qui fut aussi le chef de la sinistre Organisation armée secrète (OAS). Et il ne s’agit que d’une liste de militants du FLN cités par Saâdi dans sa « confession », qui n’apporte rien de décisif.
En revanche, Algeria-Watch, ayant obtenu communication de plusieurs documents inédits à ce jour (sauf un seul), issus des archives de l’armée française et dont nous avons pu assurer l’authenticité (voir encadré), est en mesure d’apporter un éclairage historique essentiel sur cette affaire : ces documents confirment largement les déclarations de 2003 des généraux Chabanne et de La Bourdonnaye sur la « collaboration » de Yacef Saâdi. Ce sont ces documents que nous analysons dans la suite de cet article, en gardant la prudence nécessaire : même si les plus personnels d’entre eux sont bien signés de la main de Yacef, il ne faut pas oublier que la rédaction en revient à ses interrogateurs de l’armée française et qu’il était alors soumis de leur part à une forte pression psychologique (mais sans commune mesure, toutefois, avec le lot commun des militants nationalistes arrêtés, régulièrement soumis aux pires tortures, souvent jusqu’à la mort).
Les comptes rendus inédits de l’armée française sur les « confessions » de Yacef Saâdi en septembre-octobre 1957, révélés par Algeria-Watch
Par les liens hypertextes associés aux titres de chaque document, Algeria-Watch rend ici accessible les fac-similés des comptes rendus établis par l’armée française suite à l’arrestation à Alger de Yacef Saâdi le 24 septembre 1957. Seul le premier de ces sept documents avait déjà été rendu public (sur le site des nostalgiques de l’Algérie française <www.salan.asso.fr>).
Pour que le lecteur puisse former son jugement sur l’attitude de Yacef face aux militaires français après son arrestation, nous rendons également public le fac-similé (provenant du même dossier) du compte rendu d’interrogatoire, par les mêmes soldats, d’Abderrahmane Benhamida, dernier chef de la ZAA à être tombé entre les mains des parachutistes de Massu, le 15 octobre 1957 (document n° 8)9.
* Document n° 1 : « Copie de la confession de Yacef, Saâdi Ben Mohamed, écrite librement », très probablement le 25.9.57, signée par lui et le gendarme Nogueira (4 pages) ;
* Document n° 2 : « Procès-verbal d’audition » de Yacef Saâdi (I), 29.9.57, signé par lui et établi par le capitaine Jacques Allaire et le gendarme Nogueira (8 pages) ;
* Document n° 3 : « Procès-verbal d’audition » de Yacef Saâdi (II), 3.10.57, signé par lui et établi par le capitaine Jacques Allaire et le gendarme Nogueira (2 pages) ;
* Document n° 4 : « Procès-verbal d’audition » de Yacef Saâdi (III), 5.10.57, signé par lui et établi par le capitaine Roger Faulques et le gendarme Nogueira (2 pages) ;
* Document n° 5 : « Note de service » « Très secret » du colonel Yves Godard, adjoint au général commandant de la 10e DP et commandant le secteur Alger Sahel, sur l’organisation de la ZAA, « d’après les déclarations de Yacef Saâdi », 6 (?).10.57 (3 pages) ;
* Document n° 6 : « Arrestation de Yacef », non daté (vraisemblablement d’octobre 1957) et non signé (3 pages) ; cette « note blanche » émanant des paras français de la 10e DP détaille certains des aspects de l’opération ayant permis l’arrestation de Yacef Saâdi et Zorah Driff (sic), « qui allait quelques jours plus tard entraîner la destruction (sic) de Ammar Ali, dit Ali la Pointe » ;
* Document n° 7 : « Affaire “Noyautage” de la ZAA, réseau B », également non daté (vraisemblablement d’octobre 1957) et non signé (4 pages) ; cette autre « note blanche » émanant des paras français rapporte comment ils ont réussi à infiltrer dans la ZAA un groupe d’agents algériens retournés, ce qui leur a permis de localiser Ali la Pointe, de le tuer et, in fine, de détruire la ZAA.
*******************************************
* Document n° 8 : compte rendu d’interrogatoire (vraisemblablement par le capitaine Jacques Allaire) de « Benhamida Abderrahmane, “Salim”, “El-Khiam”, chef politique de la zone autonome d’Alger », 20 octobre 1957 (11 pages) ; Benhamida n’y révèle rien de décisif, mais, surtout, ses propos d’une grande dignité rapportés par ce document attestent d’un sens politique, d’une hauteur de vue et d’un souci constant de protection de la population face à la sauvagerie de la répression militaire française (qu’il a le culot de dénoncer froidement) contrastent singulièrement avec ceux de Yacef rapportés par les soldats qui l’ont interrogé. Ce document étonnant, et très fort, se conclut d’ailleurs par cette phrase : « Il est vrai que l’organisation a été démantelée, même détruite complètement jusqu’à la dernière “pierre”. Néanmoins, un espoir réside : c’est que des hommes sincères et idéaux surgiront et bâtiront une autre organisation. » Une phrase qui sonne comme une claque à la face des ennemis qui l’ont arrêté et qu’ils ont dû enregistrer. Une phrase dont on ne trouve aucun équivalent dans les « confessions » de Yacef Saâdi…
Les vrais aveux des « confessions » de Yacef Saâdi aux militaires français en 1957
Un parcours militant ambigu
Dans le document n° 1 que nous publions, « Copie de la confession de Yacef, Saâdi Ben Mohamed, écrite librement », établi dès le lendemain de son arrestation, celui-ci retrace d’abord rapidement son parcours militant, au fil d’assertions aussi étranges qu’ambiguës, visant à l’évidence à témoigner que c’est « malgré lui » qu’il a été entraîné dans le combat nationaliste. Dès le premier paragraphe, il affirme : « Ayant rendu d’énormes services au parti (Parti du peuple algérien) par la propagande et par le recrutement, je fus muté à l’OS (Organisation secrète). » La formulation est surprenante dans la bouche d’un militant nationaliste, qui semble s’exprimer avec le détachement d’un fonctionnaire décrivant sa carrière, alors qu’en 1947, le PPA et son OS agissaient évidemment dans la clandestinité. Il précise par la suite qu’il fut membre instructeur de l’OS de 1947 à 1949, mais qu’il l’a alors quittée : « J’ai dû démissionner de cette organisation, ou plus exactement m’enfuir en France, rapport à quelques dirigeants usant de parti pris et n’étant pas à [la hauteur] de leur tâche. » Une explication vague à souhait : sans préciser l’objet du litige, il dénigre des dirigeants de l’organisation devant des soldats ennemis, qui n’en demandaient sans doute pas tant.
Après cette déclaration liminaire, il explique qu’il se réfugie en France de 1949 à 1952. Alors éloigné de toute activité politique, il ne retourne en Algérie que pour s’occuper de la boulangerie de son père. De 1952 à 1954, Yacef est resté en dehors de la dynamique nationaliste, puisque, dit-il, ce n’est que « vers la fin 1954 » qu’il est contacté par une figure du mouvement nationaliste, Zoubir Bouadjadj, venu lui annoncer le déclenchement de la guerre de libération. Ayant alors intégré le FLN, explique-t-il, il fait état d’un voyage en Suisse début 1955, où il est envoyé pour prendre contact avec la délégation extérieure du jeune parti, une structure qu’il qualifie de « Ben Bella et sa clique ». Arrêté le lendemain de son arrivée en Suisse, il est transféré à la prison civile d’Alger, où il séjournera quatre mois. « J’ai été relâché sous condition. Je n’ai pu remplir cette condition en raison de la [suspicion de] l’organisation à mon égard. Je me suis dégagé de toute responsabilité et je suis parti en France, précisément à Toulon. » C’est la seconde fois en cinq ans que Yacef Saâdi s’éloigne du mouvement nationaliste. Un comportement qui ne ressemble guère à celui d’un homme convaincu par une cause.
Il explique ensuite dans sa « confession écrite librement » qu’à son arrivée à Toulon (en octobre 1955), il est abordé par un « Nord-Africain » qui lui remet un pli dans lequel il trouve un message lui signifiant de « rejoindre Alger, sous peine de mort ». « Je fus obligé de revenir immédiatement et depuis ce fût la clandestinité au sein du FLN, poursuit-il. Il me fallait donner des preuves et être bien compromis. Le but de ceux qui m’avaient appelé avait bien réussi, j’étais bel et bien compromis. » Selon ces aveux circonstanciés, Yacef Saâdi aurait donc réintégré le FLN sous la contrainte…
En tenant ce discours, l’ancien chef de la ZAA semble précéder les attentes de ses interrogateurs français et légitimer la propagande colonialiste qui prétendait que les Algériens étaient forcés d’adhérer au combat indépendantiste. Dans leur tonalité comme dans leur substance, les propos de Yacef Saâdi sont à des années-lumière des déclarations de Larbi Ben M’hidi, son prédécesseur à la tête de la ZAA, lesquelles sont restées gravées dans l’histoire. Lorsque le capitaine Jacques Allaire lance à ce dernier lors de son arrestation le 28 février 1957 : « Vous êtes le chef de la rébellion, vous voilà maintenant entre nos mains, la bataille d’Alger est perdue ! La guerre d’Algérie, vous l’avez perdue maintenant ! », Ben M’hidi répond : « Ne croyez pas ça ! Vous vous souvenez du Chant des partisans : “Ami, si tu tombes, un ami sort de l’ombre à ta place”10. » Et quand, une semaine plus tard, lors d’une conférence de presse organisée à Alger par le général Massu, un journaliste demande à Ben M’hidi s’il ne regrettait pas l’utilisation des bombes, ce dernier répond du tac-au-tac : « Donnez-nous vos bombardiers, Monsieur, on vous donnera nos couffins. »
Yacef Saâdi ne dirigera la branche militaire de la ZAA qu’après l’arrestation de deux de ses chefs, en l’occurrence Mustapha Fettal (d’octobre 1955 à mars 1956), dirigeant charismatique du FLN, et Bouchafa Belkacem (d’avril à août 1956). Yacef précise dans son audition qu’à son retour à Alger il ne bénéficiait pas de la confiance du FLN, car selon ses propres mots, il était « surveillé » par Mustapha Fettal. Une fois ses deux prédécesseurs hors circuit, Yacef Saâdi accèdera à la direction de la ZAA.
À propos des attentats à la bombe du FLN : la révélation d’un chapelet de noms et d’adresses
Quand il aborde dans sa « confession » du 25 septembre 1957 la question des attentats à la bombe perpétrés à Alger depuis septembre 1956 et ayant fait depuis des dizaines de victimes – c’est le principal objet de ce bref « document n° 1 » –, il se met à table sans ambiguïté : « J’ai été toujours contre, mais hélas, il fallait respecter les ordres. » Il était donc, selon lui, le simple exécutant des instructions de sa hiérarchie. Yacef Saâdi raconte qu’après les attentats à la bombe de la rue Colonna-d’Ornano (Maurétania, bombe non explosée) et de la rue Michelet (La Cafétéria, quatre morts) du 30 septembre 1956, en riposte à l’attentat aveugle de colons ultras rue de Thèbes, au cœur de la Casbah, qui avait tué des dizaines d’« indigènes » le 10 août précédent, il a reçu un « blâme » du CCE (Comité de coordination et d’exécution) du FLN : celui-ci lui demandait d’être « plus sec » et lui indiquait « que le moment est favorable pour que la minorité européenne reconnaisse nos droits ». Il explique ensuite que lorsqu’il s’est rendu compte de la puissance du plastic, il a décidé d’épargner les « êtres humains » ; pour ce faire, il prenait soin de choisir l’heure ou le jour de l’explosion. Mais « je fus de nouveau harcelé par le CCE », dit-il, chargeant au passage Benyoucef Benkhedda (membre du CCE).
Yacef Saâdi égrène dans ce document avec précision les noms des auteurs des attentats. « La Cafétéria, le Milk-Bar, le Maurétania et un bâtiment de l’avenue de la Marne, contrairement à ce que certains ont pu dévoiler, voici les personnes qui ont placé ces bombes : Cafétéria, Samia Lakhdari ; le Milk-Bar, Danielle (pseudonyme), fille de mère française et de père musulman, tous deux instituteurs boulevard de Verdun, Alger (sont actuellement à la prison civile) ; le Maurétania, Zoulikha, nom pas connu, mais qui a une sœur habitant chez un médecin rue Colonna-d’Ornano ; avenue de la Marne, le groupe armé de Bencherif Omar et Ali Moulay. »
Il explique également que les bombes n’étant pas au point, il a dû mettre sur pied un « véritable labo » à l’extérieur de la Casbah « par mesure de sécurité ». Il indique qu’un certain Saïd Smaïl a offert son domicile pour la fabrication des bombes, mais ce « labo » n’a pas duré longtemps en raison d’une explosion qui a coûté la vie à Rachid Kouache. Yacef Saâdi sollicite alors Mustapha Bouhired (l’oncle de Djamila Bouhired, devenue plus tard une icône de la révolution algérienne), qui accepta « avec hésitation », précise-t-il. Après avoir trouvé le laboratoire, il constitue une équipe composée de Taleb Abderrahmane, Chérif Debbih, Abdelghani Benrezzouane, Saïd, Mustapha Ladjali et Salah Bazi.
Il indique aussi que les attentats des rues Colonna-d’Ornano et Michelet ont été commis respectivement par Zoulikha et Djamila Bouazza. Il raconte que Zohra Drif, avec qui il a été arrêté, lui avait été présentée par Abdallah Kechida, dit Mourad, et qu’elle devait se charger des liaisons. Hassiba Ben Bouali lui a été également présentée par le même Kechida. Yacef Saâdi n’est pas avare sur les détails de l’organisation : « Djamila Bouhired était en contact avec Zoulikha, qui lui transmettait du courrier destiné aux autres filles », précise-t-il. Après la mort de Larbi Ben M’hidi et le démantèlement des réseaux au printemps 1957, il raconte qu’il avait dû reconstituer l’organisation autour de Djamila Bouhired, Zohra Drif, Hassiba Ben Bouali, Chérif Debbih et Ali Ammar (Ali la Pointe). Ce noyau sera rejoint par Hattab Mohamed et Belhafaf (dit Houd).
Dans son récit, Yacef Saâdi s’étale curieusement sur Chérif Debbih, le chef du « réseau bombes » de la ZAA, en commençant par le déprécier : « Chérif Debbih, bien connu sous le nom de Si Mourad, avait quitté Alger le mois de juillet 1955 après l’arrestation de Ben Moukadem. Ayant commis une bêtise au maquis, il fut obligé de fuir pour venir à Alger. Il fut condamné à mort par le FLN. Je l’avais repêché et j’ai pu obtenir sa grâce. Soudeur de son métier, il entra à l’œuvre avec l’équipe des bombes. » Et pourtant, contrairement à Yacef Saâdi, Chérif Debbih a refusé de se rendre aux militaires français : il a été tué le 24 août avec Ramel (Hadji Athman) après une bataille mémorable contre les soldats qui encerclaient sa cache à la Casbah11, un mois jour pour jour avant l’arrestation et le déballage de Yacef Saâdi, bataille dont ce dernier ne souffle mot. À l’opposé de ce propos frôlant l’indécence, on peut citer ce que dira au sujet de Chérif Debbih aux parachutistes qui l’interrogeaient Abderrahmane Benhamida (dernier chef de la ZAA à être tombé entre les mains des parachutistes de Massu, le 15 octobre 1957) : « Le frère Si Mourad est un de ces éléments qui ont reçu une formation politique par étapes. […] Il a acquis dans le domaine révolutionnaire un riche bagage. […] Il s’est forgé des méthodes d’agir justes, raisonnables. […] Révolutionnaire extrémiste, rusé, expérimenté, il était sensible et très humain12. »
En conclusion de ce premier document, Yacef Saâdi évoque l’affaire Melouza – terrible massacre de plus de trois cents habitants d’un village des confins orientaux de la Kabylie, perpétré le 29 mai 1957, dont on saura plus tard qu’il avait été le fait d’hommes du FLN13. Ce passage prend l’allure d’un météorite tombé de nulle part, puisque cela ne concernait nullement la bataille d’Alger. Pourquoi Yacef a-t-il évoqué ce sombre épisode de la Révolution algérienne, survenu quatre mois avant son arrestation ? Il affirme alors aux parachutistes : « J’avais juré, si cette boucherie était l’œuvre du FLN, de me rendre auprès des autorités et [d’]amener tout Alger à se rallier. » Finalement, après enquête, il dit avoir eu la confirmation auprès de ses responsables que le FLN n’y était pour rien – ce qui était faux, mais il a peut-être été abusé. Quoi qu’il en soit, Yacef Saâdi semble encore une fois vouloir faire bonne figure devant ses geôliers : il veut donner l’image d’un humaniste ne cautionnant pas les éventuelles dérives de son propre mouvement, le FLN. Et il fanfaronne en prétendant que son prétendu ascendant sur toute la population algéroise lui aurait permis de la rallier à la France coloniale…
Tous les détails sur la structuration de la ZAA
Dans le document n° 2 du 29 septembre 1957, soit cinq jours après son arrestation, Yacef Saâdi décrit dans le détail aux parachutistes français l’organisation de la ZAA. Le document est sous forme de questions-réponses.
Il y révèle en préambule la nature des liens entre le FLN et l’UGTA (Union générale des travailleurs algériens) et l’UGCA (Union algérienne des commerçants algériens). Il explique ainsi qu’après la « grève des huit jours » de janvier-février 1957, c’est Benyoucef Benkhedda qui entretenait les liaisons avec l’UGTA. Il indique que le syndicat a été complètement détruit après la grève et que les rescapés ont pris les chemins du maquis ou de l’étranger. « Le seul dirigeant actuel est Abdelmadjid (Amar Ouzegane) », poursuit-il. Il raconte que ce dernier est entré en contact avec lui par l’intermédiaire de Chérif Debbih. Commence ainsi une correspondance entre les deux dirigeants par l’entremise de Mahmoud (l’agent de liaison de Saâdi) et Fettouma Rebaïne (la nièce d’Ouzegane). Yacef indique que le dirigeant de l’UGTA était quasiment seul et réclamait de l’aide pour mettre sur pied les moyens d’impression (il lui a remis 1 500 000 francs pour l’achat du matériel). Il conclut qu’il n’a plus eu de contact avec Ouzegane (1910-1981) depuis le début septembre 1957. Le dirigeant de l’UGTA sera arrêté en janvier 1958 et Yacef Saâdi aura le loisir de le connaître personnellement, puisque tous deux seront incarcérés plus tard à la prison de la Santé à Paris.
Abordant ensuite l’organisation de la ZAA, son chef explique qu’il a sous ses ordres le chef militaire (Zerrouk), le commissaire politique Abderrahmane Benhamida, dit El-Khiam, qui sera arrêté trois semaines après lui. La branche Liaisons et renseignements est dirigée par Mohamed Hadjsmaïn, dit Kamal, arrêté quant à lui peu avant Yacef. Le chef de cette dernière branche est aidé par un ou deux adjoints qui sont chargés d’un comité de rédaction composé de Mahfoud, Arlette, Mimi Bensmaïn, dite Renée, et de Farida. Un comité sanitaire était en voie d’être mis en place, mais les contacts avec d’anciens camarades de Yacef (un pharmacien et un dentiste) n’ont pas eu lieu. Le comité de renseignement dirigé par Kamal était chargé d’infiltrer l’administration, la police et l’armée. Le comité liaisons s’occupait du courrier avec les wilayas et l’extérieur. Enfin, un comité de justice était chargé de régler des conflits au sein de la population.
Les modes de financement de la ZAA
Le document n° 3 et le document n° 4, respectivement datés des 3 et 5 octobre, prolongent l’interrogatoire précédent de Yacef, toujours sous forme de questions-réponses. Ils concernent le financement de la ZAA, passant d’une part, par le « Comité des halles et des marchés », chargé des « collectes au sein des halles », et, d’autre part, par la « commission financière » chargée des grosses impositions. Yacef Saâdi indique que cette dernière a été mise en place en 1956 par Benyoucef Benkhedda. Il révèle que cette commission devait collecter des fonds auprès des « gros commerçants et les personnalités qui ne pouvaient être contactés par les collecteurs locaux ». Il affirme que parmi les membres il y avait « Benchicou et d’autres commerçants et industriels ». Il mentionne également des personnes qui « y ont au moins collaboré : Tamzali (père), Guellati, Bengana, Thiar, Abbas Turqui et Belloul ». Il précise qu’Abbas Turqui a servi de boîte postale et que Belloul, ancien avocat, est « actuellement tenancier d’un café d’une rue qui part du Square-Bresson ». Deux noms sont ajoutés : Ali Khodja et le bachagha Boutaleb, dont le domicile a servi de refuge à Larbi Ben M’hidi et de laboratoire de fabrication de bombes.
Le document n° 5, datant probablement du 6 octobre (la mention manuscrite de la date n’est guère lisible), donne une brève synthèse des deux documents précédents : il s’agit d’une officielle « note de service » estampillée « Très secret » du colonel Yves Godard, adjoint au général commandant de la 10e DP et commandant le secteur Alger Sahel – l’un des principaux responsables de la « bataille d’Alger » –, adressée à ses principaux collaborateurs (civils et militaires) et responsables hiérarchiques sur l’organisation politique et financière de la ZAA, « d’après les déclarations de Yacef Saâdi ». L’existence même de cette « note » indique l’importance, pour les officiers français, de la collaboration spontanée dont ce dernier avait fait preuve après son arrestation : ces officiers connaissaient déjà sans doute une bonne partie de ses « révélations », mais le fait même que le chef de la ZAA ait « lâché le morceau » « sans avoir besoin de lui mettre une claque », tout en dénigrant au passage la légitimité de plusieurs responsables nationalistes, devenait une arme essentielle d’« action psychologique » à mobiliser pour démoraliser et neutraliser les derniers combattants du FLN à Alger.
Les circonstances de l’arrestation de Yacef et de l’assassinat d’Ali la Pointe
Les documents n° 6 et 7, provenant du même dossier d’archives que les précédents documents que nous rendons publics, confirment le rôle de l’« action psychologique », mais aussi d’autres méthodes plus « directes », dans le travail d’enquête, d’infiltration, puis de démantèlement, visant la ZAA et ses responsables : il s’agit de deux « notes blanches » non datées et non signées, probablement rédigées en octobre 1957 par les agents de renseignements de la 10e DP, explicitant respectivement l’« arrestation de Yacef » et l’« affaire “Noyautage” de la ZAA, réseau B ».
Le document n° 6 résume en trois feuillets la très complexe enquête « à tiroirs » qui a permis aux parachutistes de parvenir à la cache de Yacef Saâdi dans la rue Caton de la haute Casbah, et d’arrêter simultanément d’autres responsables de la ZAA. Curieusement rédigée dans un style de « polar » plutôt que de rapport de police, cette « note blanche » en dit long, en filigrane, sur les méthodes expéditives utilisées : plusieurs personnes arrêtées et interrogées ont été, est-il dit notamment, « pressées de questions », on imagine de quelle façon…
Dans le même style d’écriture de polar relâchée et imprécise, le document n° 7 est plus étonnant encore, soulevant de nouvelles questions. Intitulé « Affaire “Noyautage” de la ZAA, réseau B », il relate en quatre feuillets comment, parallèlement à l’enquête relatée dans le document précédent, une « unité para de la 10e DP » avait réussi à infiltrer la ZAA à haut niveau. Cette note blanche, où il est beaucoup question d’« AL » (agents de liaison) et de « BL » (boîtes aux lettres), explique comment les paras ont utilisé un certain « B » qu’ils avaient retourné, récemment désigné « responsable militaire de la ZAA » par Yacef Saâdi : il n’est pas nommé, mais on a vu qu’il s’agissait d’Hacène Ghendriche, alias Zerrouk, retourné secrètement en août 1957 par le capitaine Léger, chef du GRE.
Grâce à ce « réseau B », indique la note, la traque d’Ali la Pointe se précise rapidement : « D’un quartier de la Casbah, on en arrive assez vite à penser que la cache se trouve dans une certaine rue, l’objectif se limite bientôt à quelques maisons. » Mais, très étrangement, la phrase suivante apporte une autre information : « La découverte finale devait, toutefois, être apportée par une tout autre filière qui ferait l’objet d’un autre récit. Ali la Pointe saute avec ses comparses. » De fait, le 9 octobre 1957, le spectaculaire dynamitage par les paras du 1er REP d’une maison de la Casbah fera de nombreuses victimes, entraînées dans la mort avec Ali la Pointe, « Petit Omar » (douze ans, agent de liaison et neveu de Yacef), Hassiba Ben Bouali et Mahmoud Bouhamidi. Épisode tragique remarquablement mis en scène dans le film La Bataille d’Alger, produit et joué par Yacef Saâdi…
Mais du coup, le mystère, loin de se dissiper, s’obscurcit à nouveau : si la planque d’Ali la Pointe n’a pas été révélée par Saâdi après son arrestation, ce qu’ont affirmé les officiers Yves de La Bourdonnaye et Raymond Chabanne, qui ont désigné Zerrouk comme responsable dans leurs témoignages des années 2000, quelle serait alors la « tout autre filière » évoquée dans le document n° 7 ? À notre connaissance, les travaux des historiens et des journalistes qui ont étudié cet épisode important de la guerre d’indépendance n’ont pas, à ce jour, éclairci le mystère.
Un travail pour l’histoire
Avant même l’arrestation de Yacef Saâdi, l’organisation de la ZAA du FLN avait déjà été très sérieusement ébranlée par de multiples arrestations. Quand il se rend, elle est presque anéantie (même si, on l’a vu, son successeur Abderrahmane Benhamida s’efforce de la maintenir quelques semaines encore). Et il obtient du colonel Godard d’être traité en tant que prisonnier de guerre – ce qui fut fait, puisqu’il n’a pas subi de torture. Après vingt-deux jours passés à la Villa Nador où il a été interrogé, il est placé en isolement à la prison Barberousse. Il sera ensuite trois fois condamné à mort, avant d’être transféré à la prison de la Santé à Paris, où il rejoindra les dirigeants du FLN.
Dans une scène de La Bataille d’Alger, initiant Ali la Pointe à la guérilla, une des répliques de Yacef dans son propre rôle résonne étrangement : « Il faut nettoyer la société des gens sans honneur, des gens qui ne pensent qu’à eux-mêmes, les gens indignes de confiance, les fanfarons, ceux qui n’ont aucune conscience. » La Révolution algérienne, comme tout mouvement historique de très grande ampleur, a inévitablement sa part d’ombres. S’agissant de la destruction de la ZAA au cours de la « bataille d’Alger », entre rodomontades d’acteurs dont la partition n’a pas été aussi glorieuse qu’ils veulent la présenter, discours convenus de l’histoire officielle et rumeurs malveillantes propagées par les nostalgiques de la période coloniale, beaucoup a été dit et écrit, au point parfois de brouiller la compréhension de ce qui s’est réellement passé. En révélant ici certains documents incontestables issus des archives militaires françaises accompagnés de cette mise en perspective, notre seule intention aura été de contribuer à dissiper certains fantasmes et contrevérités sur cette tragique page d’histoire, dont la dimension essentielle doit être toujours rappelée : l’engagement admirable et désintéressé de dizaines de milliers de femmes et d’hommes pour la libération de leur pays du joug colonial. Car, ne l’oublions pas, les documents militaires publiés ici sont d’abord accablants pour leurs auteurs, devenus tortionnaires pour tenter de briser ce mouvement de libération.
Cette publication ne vise donc pas à nourrir un quelconque procès, que l’Histoire a de toute façon déjà instruit : malgré la torture, malgré les assassinats et les trahisons, le peuple algérien n’est plus sous le joug colonial. Et même si son chemin vers la pleine liberté est encore long, il est balisé par le sacrifice de ceux qui ont tout donné pour l’indépendance sans rien attendre en retour. Par fidélité et respect à leur mémoire, il est essentiel que leur histoire soit pleinement reconnue, que les falsifications qui courent encore soient définitivement écartées. Le passé est toujours présent, il constitue même une partie significative de ce présent tourmenté. Contribuer à lever les zones d’ombre ne consiste nullement à accuser les uns ou à glorifier les autres : l’histoire du mouvement national est celle d’un formidable élan libérateur et elle mérite d’être écrite dans toutes ses dimensions, les plus glorieuses comme les plus terribles. Tel est le sens ultime de cette contribution.
Notes
1 Said Rabia, « Campagne contre Zohra Drif et Yacef Saâdi. L’ignoble lynchage », El Watan, 20 janvier 2016.
2 Dans l’immense bibliographie consacrée à cette histoire, on peut distinguer la très utile synthèse franco-algérienne publiée en 2012 : Abderrahmane Bouchène, Jean-Pierre Peyroulou, Ouanassa Siari Tengour et Sylvie Thénault (dir.), Histoire de l’Algérie à la période coloniale, 1830-1962, La Découverte/Barzakh, Paris/Alger, 2012.
3 « Yacef Saâdi jette un pavé dans la mare. Il accuse Ighilahriz de n’avoir pas pris part à la révolution », Le Soir d’Algérie, 28 avril 2011.
4 Kamel Redouane, « Yacef Saadi accuse Zohra Drif d’avoir “vendu” Ali la Pointe », ChoufChouf, 24 janvier 2014.
5 Elyas Nour, « Yacef Saadi remet en cause les sacrifices des martyrs Larbi Ben M’hidi et Ourida Medad », <Algérie-Focus.com>, 17 mars 2014.
6 Marie-Monique Robin, Escadrons de la mort, l’école française, La Découverte, Paris, 2004, p. 116-117 (ouvrage détaillant le documentaire télévisé de la même auteure, diffusé sous le même titre par Canal Plus et Arte en septembre 2003).
7 Ali Boukhlef, « Le document récupéré sur le site du général Salan. Les archives, objet de manipulation politique », El Watan, 20 janvier 2016.
8 Sous le titre : « Synthèse établie par le colonel Godard, d’après les confessions de Yacef Saadi et Drif Zohra, sur une quarantaine de membres du FLN », 8 octobre 1957, <www.salan.asso.fr>. Parmi d’autres documents publiés par le site, trois concernent l’arrestation de Yacef Saâdi. Les deux premiers n’ont qu’un intérêt relativement secondaire : « Procès-verbal d’audition de Yacef Saadi sur le rôle de Hatab (dit Habib) Reda dans le réseau de poseurs de bombes du FLN à Alger », 25 septembre 1957 ; « Procès-verbal d’audition de Yacef Saadi sur le rôle d’Hassiba Ben Bouali », 10 octobre 1957. Tandis que le troisième, sur lequel nous reviendrons, est plus instructif : « Copie de la confession de Yacef, Saâdi Ben Mohamed, écrite librement », 25 septembre 1957.
9 Abderrahmane Benhamida (1931-2010), condamné à mort en juillet 1958, bénéficiera d’une grâce présidentielle et sera libéré après les accords d’Évian. Premier ministre de l’Éducation nationale de l’Algérie indépendante (1962-1963), il se retirera ensuite de la vie politique.
10 Cité in Yves Boisset, La Bataille d’Alger, France 2, 2006.
11 Voir Gilbert Meynier, Histoire intérieure du FLN, 1954-1962, Fayard, Paris, 2002, p. 326.
12Document n° 8 : compte rendu d’interrogatoire de « Benhamida Abderrahmane, “Salim”, “El-Khiam”, chef politique de la zone autonome d’Alger », 20 octobre 1957.
13 Gilbert Meynier, Histoire intérieure du FLN, 1954-1962, op. cit., p 453.